Job Summary
UTS has a bold vision to be a world-leading university of technology. We are a dynamic and innovative university in central Sydney, consistently ranked the top young university in Australia. With a culturally diverse campus life and extensive international exchange and research programs, UTS prepares graduates for the workplaces of today and tomorrow.
Detailed Description
The School of International Studies, FASS, UTS, is seeking to appoint an Associate Professor in French and Francophone Studies to teach and research in the area of French Studies.This position will also provide the leadership role in mentoring, coaching and leading all the foreign languages courses in the School.
In this role, you will:
- Teach in, and coordinate, the French Language & Culture curriculum, beginner through to upper levels
- Participate in, and provide leadership for, areas pertaining to language and culture research and pedagogy in the French section, and across the language and culture programs in the School;
- Attract high quality postgraduate research students and supervise postgraduate research projects;
- Contribute to, and build research capacity in, the School by procuring competitive research grants, participating in or leading significant research projects, working with other staff to build research links and mentoring the research of other individuals and groups within the School/Faculty; and
- Participate in a range of external engagement activities though involvement in any variety of consulting, public seminars, engagement with relevant industry, professional organisations, alumni activities, and other related tasks.
To be successful in this role, you will have:
- A high level proficiency in French and English.
- Demonstrated history of excellence in language curriculum development.
- An excellent track record of publications and/or grants in the field, commensurate with opportunity.
- Demonstrated research capability and higher research degree supervision, as shown through a research trajectory statement, in any of the areas of French language pedagogy, cultural studies or social science research.
- A doctoral qualification in an area related to the position.
- Demonstrated successful experience in French language and culture teaching and curriculum development, beginner through to upper-intermediate levels.
Fluency in a second European language relevant to the International Studies program would be of additional interest to the selection panel however is not essential.
Remuneration
Base Salary Range: $149,355 to $159,049 (Level D)
This role attracts 17% superannuation in addition to the base salary.
Our commitment to work/life support includes benefits such as flexible work practices, child care centres, generous parental leave and support to carers.
Whilst as Australia’s premier city, Sydney is consistently ranked in the top 10 cities worldwide for quality-of-living.
This position is full-time and appointment will be made on a continuing basis.
How To Apply
Prior to commencing your application for IRC112136, please review the Position Statement and the relevant selection criteria – Click on the apply link to be taken to the relevant page.You are required to address the selection criteria in your submission in a separate document.
Please note that only those applications submitted via the UTS online recruitment system will be accepted. Current UTS employees should apply through their UTS Employee Self Service function.
As you will be unable to save your application once started, please have all required documents and information available prior to commencing.
Please ensure that the file name for each document submitted includes IRC112136.
Specific enquiries or issues with your application may be directed to the UTS Recruitment Team at recruitment@uts.edu.au or on +61 (0) 2 9514 1080.
Please be advised that as part of the selection process that you may be requested to deliver a presentation, the audience for which may include individuals not on the Selection Panel.
Closing Date: Tuesday 31st July 2018 at 11.59pm (AEST)
Please note: We are only accepting on-line applications for this post, however, if you have a disability that makes it difficult for you to provide us with information in this way, please contact the Recruitment Team for assistance.
We are committed to diversity and social inclusion, evidenced by our WGEA Employer of Choice citation, Wingara Indigenous Employment Strategy and the UTS Access and Inclusion Plan. We welcome applications from women (particularly for senior and non-traditional roles), Indigenous Australians, people with disability, those who identify as LGBTIQ and applicants from culturally and linguistically diverse backgrounds.

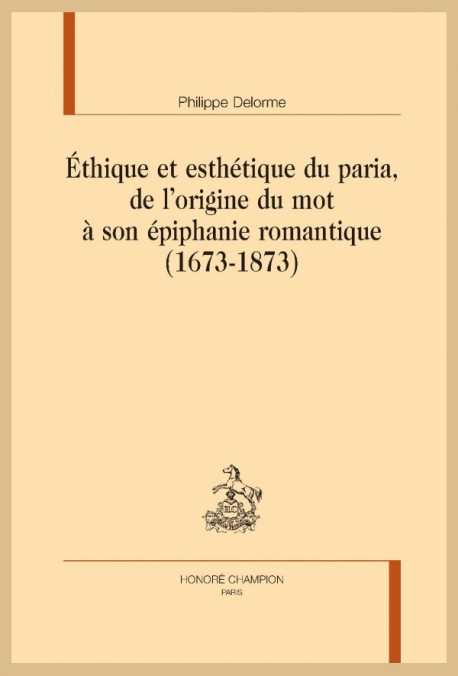 Philippe Delorme, Éthique et esthétique du paria, de l'origine du mot à son épiphanie romantique (1673-1873), Paris, H. Champion, 2024.
Philippe Delorme, Éthique et esthétique du paria, de l'origine du mot à son épiphanie romantique (1673-1873), Paris, H. Champion, 2024. Palacios, Joy. "Antitheatrical Prejudice: From Parish Priest to Diocesan Rituals in Early Modern France." Theatre Survey, no. 2 (2023): 117-49.
Palacios, Joy. "Antitheatrical Prejudice: From Parish Priest to Diocesan Rituals in Early Modern France." Theatre Survey, no. 2 (2023): 117-49. 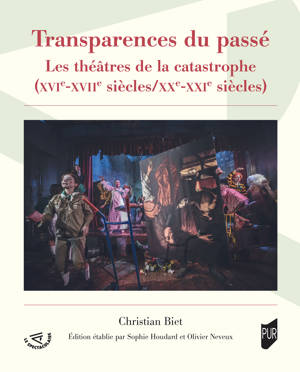 Christian Biet, Transparences du passé Les théâtres de la catastrophe (XVIe-XVIIe siècles/XXe-XXIe siècles), éd. Olivier Neveux et Sophie Houdard-Biet, Rennes, PUR, 2023.
Christian Biet, Transparences du passé Les théâtres de la catastrophe (XVIe-XVIIe siècles/XXe-XXIe siècles), éd. Olivier Neveux et Sophie Houdard-Biet, Rennes, PUR, 2023.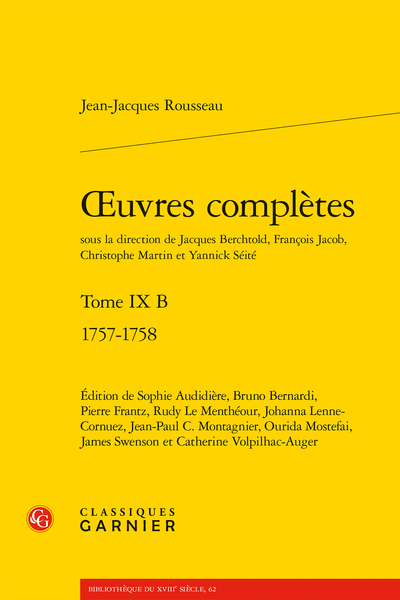 Œuvres complètes. Tome IX B 1757-1758, éd. Berchtold (Jacques), Jacob (François), Martin (Christophe), Séité (Yannick), Paris, Classiques Garnier, 2024.
Œuvres complètes. Tome IX B 1757-1758, éd. Berchtold (Jacques), Jacob (François), Martin (Christophe), Séité (Yannick), Paris, Classiques Garnier, 2024.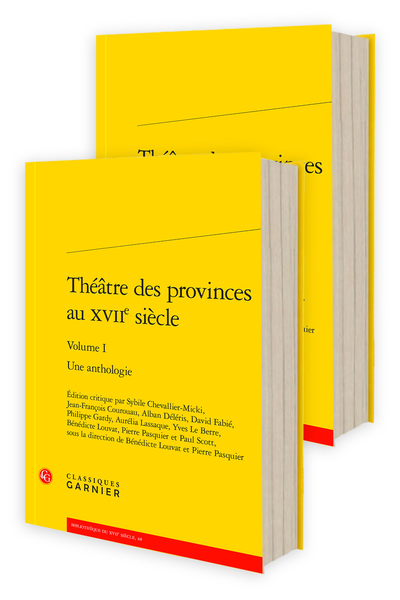 Théâtre des provinces au xviie siècle. Une anthologie, éd. Bénédicte Louvat et Pierre Pasquier, Paris, Classiques Garnier, 2024.
Théâtre des provinces au xviie siècle. Une anthologie, éd. Bénédicte Louvat et Pierre Pasquier, Paris, Classiques Garnier, 2024.