(English version below)
14-16 avril 2022
Yale University – New York University
Les dernières décennies ont profondément transformé l’étude de Molière : abandonnant les figures
du saltimbanque mélancolique, du malade chronique ou de l’auteur romantique qui imprègnent
encore l’imaginaire collectif, les recherches sur le comédien-auteur font désormais la part belle à
ses collaborations, ses influences et ses sources, à la sociologie et aux conditions matérielles de son
théâtre, ainsi qu’aux approches interdisciplinaires. Ce renouvellement tend cependant à maintenir
Molière au centre de la réflexion : il demeure le point de fuite à partir duquel s’organisent la pensée,
les optiques interprétatives et les récits historiques.
Ne pourrait-on pas changer de point de vue, voire d’échelle ? Quelle histoire raconterait-on si l’on
adoptait la perspective de ses contemporain·e·s, libraires-éditeurs (notamment Ribou),
auteurs·trices (Desjardins, Somaize, Donneau…), artistes (Beauchamp, Charpentier, Chauveau…)
ou gazetiers (Subligny, Robinet…) ? Quelles nouvelles pistes se dessinent lorsque, au lieu de
présupposer le génie de Molière ou de présumer son succès, on le considère comme un acteur parmi
d’autres dans le champ littéraire des années 1660 ? Qu’observe-t-on en élargissant le cadrage, en
privilégiant des questions transversales (paramètres économiques, enjeux religieux, propagande et
historiographie, écriture du lointain et goût des voyages, jeu et scénographie, etc.) ou en abordant
ses pièces à partir d’autres champs d’études (musicologie, histoire de l’art, histoire du livre, arts du
spectacle, etc.) ?
Les 400 ans du comédien-auteur sont l’occasion de reconfigurer ce « moment Molière » par un
geste à la fois historiographique et méthodologique : mettre au premier plan les auteurs·trices,
corpus, pratiques, usages et approches souvent tenus en marge de la discussion critique ou limités
à des rôles ancillaires. Au lieu de réfléchir à partir de Molière et de son oeuvre, nous invitons ainsi
des communications qui s’appuient sur d’autres auteurs·trices, d’autres genres, d’autres arts,
d’autres lieux ou d’autres champs d’études. Très concrètement, il ne s’agit pas seulement d’enrichir
l’étude du Bourgeois gentilhomme par l’histoire du ballet, mais bien de partir de l’histoire du ballet
pour réinscrire Le Bourgeois gentilhomme dans une pratique et des usages plus larges ; d’étudier
les raisons pour lesquelles Chauveau a illustré les oeuvres de Molière et de cerner la place
qu’occupent ces gravures dans la production de l’artiste ; d’observer comment les gazettes traitent
de théâtre, de littérature et de musique en général afin de relire le discours qu’elles tiennent sur
Molière ; de repenser la première scène de La Comtesse d’Escarbagnas à l’aune des discours
contemporains sur le contrôle de l’information ; de comprendre que le Récit de la farce des
Précieuses ou l’édition du Cocu imaginaire ne sont pas de simples transcriptions des pièces, mais
des opérations éditoriales complexes qui dépassent de loin la seule question de Molière.
En décentrant Molière, ce colloque espère ainsi présenter des éclairages inédits sur la production
culturelle du XVIIe siècle, réévaluer le sens et la hiérarchisation de nos objets d’études, voire
déconstruire certains mythes et questionner l’évidence de certains récits établis. Moins qu’un
nouveau débat sur la légitimité du canon, il s’agit de visibiliser une histoire plurielle, soucieuse des
multiplicités et consciente de ses points aveugles. Le colloque sera également l’occasion de mettre
en scène, en voix ou en espace, dans leur totalité ou partiellement, des pièces issues de cette période
et rarement montées aujourd’hui.
Dans cette perspective, nous invitons des communications qui proposent de nouvelles manières
d’aborder Molière, son théâtre et son activité en adoptant un ou plusieurs des angles suivants :
– auteurs·trices, acteurs·trices, danseurs·euses, artistes, libraires… contemporain·e·s de
Molière ;
– pratiques et enjeux de la première modernité (fêtes de cour, historiographie, usages
publicitaires, querelle des femmes, réseaux d’échanges et de voyages, techniques de
scène…) ;
– genres non dramatiques (romans, nouvelles, poésie, mémoires, récits de voyage,
illustration, musique, danse…)
– aires géographiques et culturelles autres que la France ;
– méthodologies émergentes (études sur le handicap, sur le marketing, sur la culture visuelle,
sur le son…) et/ou concepts théoriques historiquement fondés ;
– construction du statut exemplaire de Molière dans la critique et dans la mise en scène ;
effets de champs que cette centralité produit sur les études dix-septiémistes et, plus
largement, littéraires et théâtrales ;
– propositions pratiques : atelier, lecture, intervention-spectacle, mise en scène…
Les langues du colloque sont le français et l’anglais.
Les propositions de communication (300 mots accompagnés d’une brève présentation de
l’auteur·trice) devront être envoyées avant le 1er février 2021 aux trois adresses suivantes :
christophe.schuwey@univ-ubs.fr
guyot@fas.harvard.edu
benoit.bolduc@nyu.edu
En fonction de leurs approches et de leurs objets d’études, les chercheurs et chercheuses
intéressé·e·s sont invité·e·s à considérer également le colloque « Retours sur Molière » qui se
tiendra en janvier 2022 à la Sorbonne et à la Comédie-Française, ainsi que les autres manifestations
annoncées sur le site Molière 2022 (http://moliere2022.org/).
-------
Call for Papers - International Conference
Decentering Molière
April 14-16, 2022
Yale University – New York University
The last few decades have profoundly altered Molière: scholars gradually laid aside the familiar
figures of the melancholic saltimbanque, the chronically sick jester, and the romantic author
forever stoking the collective imagination. Instead, recent studies of the author and actor begin with
his collaborations, his sources, and his influences, drawing our attention to the social and material
conditions of Molière’s practice, and from interdisciplinary perspectives. And yet, this shift keeps
Molière at the center: he remains the vanishing point around which critical and historical analysis
is constructed.
Can we find a more radical shift in our point of view? Recalibrate our scale? What histories might
we tell if we were to adopt the perspective not of Molière, but of his contemporaries—of publishers
(Ribou, for example), authors (Desjardins, Somaize, Donneau…), choreographers, composers, and
visual artists (Beauchamp, Charpentier, Chauveau…), or gazetteers (Subligny, Robinet…)? What
paths might we open if we think of Molière not as a genius, from the perspective of an established
legacy, but as one of many social actors in the literary field of the 1660s? What might we discover,
or discern more clearly, if we focus on cross-disciplinary historical practices (economic issues,
religious matters, propaganda, historiography, culture of travels, stage design…), and/or structure
our own histories according to multiple fields of study (musicology, art history, history of the book,
performance studies…)?
The four-hundredth anniversary of Molière’s birth provides a stage to rethink the Molière moment
on both historiographical and methodological levels. In particular, we hope to shift our attention to
those authors, writings, practices, and styles commonly confined to the margins of critical
discussion. Thus, instead of taking Molière as our starting point, we invite proposals focused on
other (less studied) writers, other genres (beyond drama), other arts (beyond belles lettres), other
places (beyond the theater), and other fields (beyond literary and drama studies). Rather than
inserting the history of ballet into a study of Le Bourgeois gentilhomme, for example, we might
begin with the history of ballet in order to inscribe Le Bourgeois gentilhomme into a larger history
of theatrical and social practice; we might consider Chauveau’s investment in illustrating Molière’s
plays from within the history of engraving and in terms of Chauveau’s own oeuvre; we might study
contemporary gazetteers’ attitudes toward literature, theater, and music generally, in order to
rethink journalistic attitudes toward Molière; we might rethink the first scene of La Comtesse
d’Escarbagnas in terms of contemporary discourses on the control of information; or we might
work to think the Récit de la farce des Précieuses or the printed edition of Le Cocu imaginaire not
as simple transcriptions of dramatic texts, but as complicated editorial processes that extend far
beyond Molière himself.
By decentering Molière, this conference aims to shed unexpected light on the cultural production
of the seventeenth century. We hope to challenge the hierarchization of our objects of study,
deconstruct some well-established myths, and question the necessity of certain historiographical
narratives. Our hope is not to stage another debate concerning the legitimacy of the canon, but
rather to render visible a more complicated history, ever attentive to diversity (both within the
seventeenth century and within our own moment) and to our own inevitable blind spots. Also with
this aim, we very much intend the conference to furnish a space for the staging of rarely performed
seventeenth-century texts, whether read or performed, as fragments or in their entirety.
Proposals might adopt one (or several) of the following perspectives or methodologies:
- Authors, performers, composers, printers, booksellers… of the time of Molière;
- The practices and stakes of early modernity (royal festivities, historiography, publicity, la
querelle des femmes, exchange and travel networks, stage technologies…);
- Non-dramatic genres (novels, stories, poetry, memoirs, travelogues, illustrations, music,
dance…);
- Geographic and cultural contexts outside of France;
- New scholarly methodologies (disability studies, marketing studies, visual culture, sound
studies…), and/or theoretical concepts based in historical research;
- The construction of Molière as a point of reference within both criticism and theatrical
practice, and the effects of Molière’s centrality in the study of French seventeenth century,
and more broadly, on literary and theater studies, in France and beyond;
- And for practitioners: workshops, lectures, performance-lectures, or performances adopting
one or several of the above perspectives.
The languages of the conference will be French and English.
Proposals—300 words, accompanied by a brief biographical note—should be sent
before February 1, 2021 to:
christophe.schuwey@yale.edu
guyot@fas.harvard.edu
benoit.bolduc@nyu.edu
Interested scholars are also invited to apply to the conference “Retours sur Molière,” which will
take place in January of 2022 at the Sorbonne and the Comédie-Française; other events, too, can
be found listed on the official page of Molière 2022 (http://moliere2022.org)

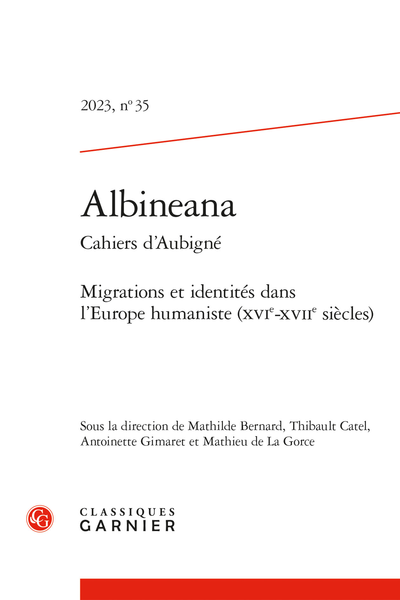 Albineana Cahiers d’Aubigné 2023, n° 35 Migrations et identités dans l’Europe humaniste (XVIe-XVIIe siècles)
Albineana Cahiers d’Aubigné 2023, n° 35 Migrations et identités dans l’Europe humaniste (XVIe-XVIIe siècles)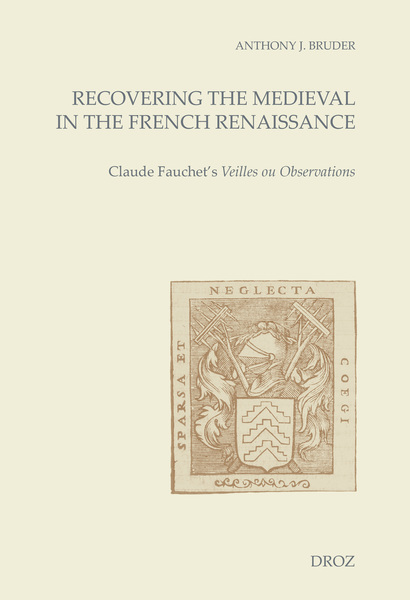 Anthony J. BRUDER, Recovering the Medieval in the French Renaissance. Recovering the Medieval in the French Renaissance: Claude Fauchet's Veilles ou Observations, Genève, Droz, 2024.
Anthony J. BRUDER, Recovering the Medieval in the French Renaissance. Recovering the Medieval in the French Renaissance: Claude Fauchet's Veilles ou Observations, Genève, Droz, 2024.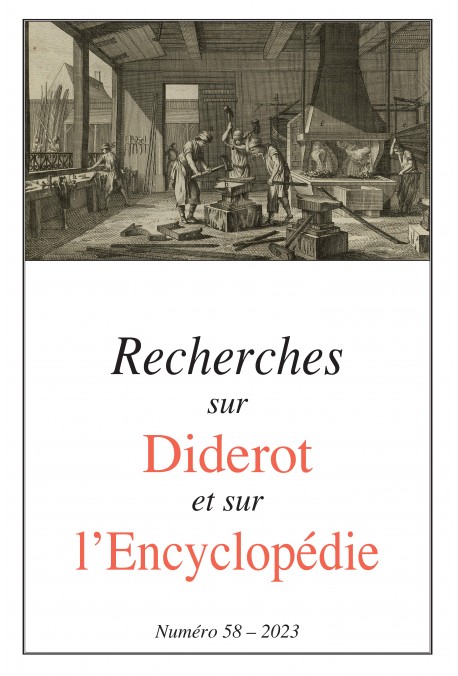 Recherches sur Diderot et sur l'Encyclopédie 58- 2023.
Recherches sur Diderot et sur l'Encyclopédie 58- 2023.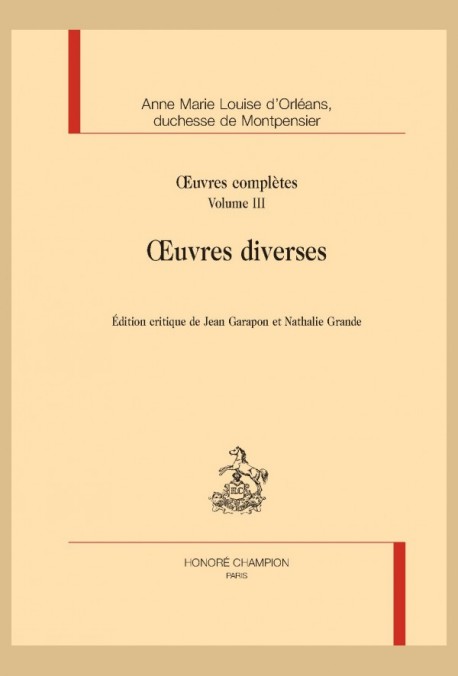 Anne Marie Louise d'Orléans duchesse de Montpensier, Œuvres complètes III et dernier : œuvres diverses, édition critique de Jean Garapon et Nathalie Grande, Paris, H. Champion, 2024.
Anne Marie Louise d'Orléans duchesse de Montpensier, Œuvres complètes III et dernier : œuvres diverses, édition critique de Jean Garapon et Nathalie Grande, Paris, H. Champion, 2024.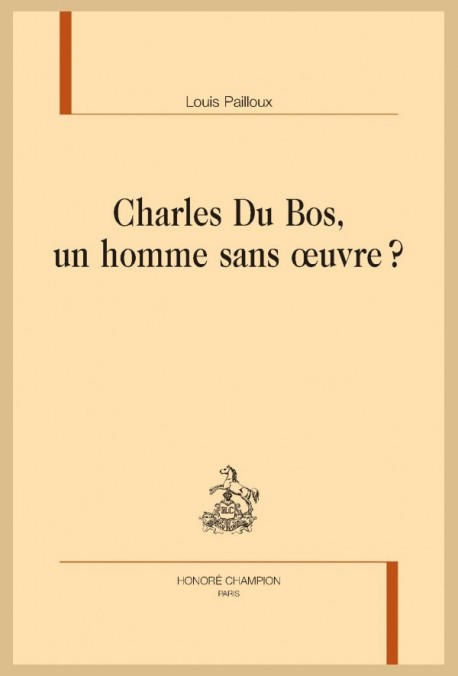 Louis Pailloux, Charles du Bos, un homme sans oeuvre ?, Paris, H. Champion, 2024.
Louis Pailloux, Charles du Bos, un homme sans oeuvre ?, Paris, H. Champion, 2024.