DOUBLE JEU n°18
Les décors de théâtre et de cinéma ont un passé commun. Longtemps, le vocabulaire employé au théâtre servit sur les plateaux de cinéma, et aujourd’hui encore des professionnels passent d’un atelier à l’autre. Pour ce nouveau numéro de Double Jeu consacré aux décors, pourquoi ne pas éveiller ces souvenirs communs, les circulations et transmissions de savoir-faire, d’inventions, mais aussi les écarts, les concurrences, le travail de distinction entre décorateurs de théâtre et décorateurs de cinéma ?
Nous proposons ainsi d’interroger la conception du décor de cinéma et de théâtre en France, jouant sur les sens du terme pour questionner à la fois les manières de penser et de fabriquer les décors. Il s’agira d’abord d’interroger les limites du terme : où commence, où s’arrête le décor ? Dans quelle mesure équivaut-il ou se distingue-t-il de la scénographie ? Du côté du théâtre, comme l’a relevé Marcel Freydefont, le mot « décor » est déclaré périmé dès les années 1960 et a connu une période de disgrâce[1]. On considère aujourd’hui le décor comme un élément du tout plus vaste qu’est la scénographie : il en est la partie construite et praticable par les acteurs, ou bien la partie peinte. Le terme a-t-il pour autant retrouvé une neutralité technique, ou conserve-t-il une connotation négative, associée à une esthétique platement réaliste ?
Au cinéma, le décor est traditionnellement défini à travers les spécialités et les outils de ceux qui le façonnent. Les diverses mutations technologiques invitent en effet constamment à interroger la nature du décor et sa place dans les films. Que ce soit en studios, en décors dits naturels ou dans le cadre d’une création numérique, le matériel technique influe sur l’appréhension de l’espace conçu. Sa fabrication impacte la manière de le penser et de le nommer. Comme Françoise Puaux le remarque en introduction du Décor de cinéma : « Le nom des artistes décorateurs varient en fonction de leur formation, des studios et des latitudes, art director ou production designer pour les anglo-saxons, architecte pour les germaniques, scénographes pour les latins, artistes-peintres pour les slaves »[2]. Dans ces conditions, au vu de la multiplicité des pratiques, comment concevoir le décor de cinéma ?
État de la recherche La recherche sur le décor a été un moyen de se distinguer d’une approche textocentriste et littéraire et a ainsi été fondatrice pour la discipline des études théâtrales. L’ouvrage de Denis Bablet Esthétique générale du décor de théâtre de 1870 à 1914[3] (1965) reste une référence importante tant du point de vue historique que méthodologique. L’intérêt porté au décor et à la scénographie s’est récemment renouvelé en empruntant deux grandes directions. Un travail historique, d’une part, tend à mieux documenter les pratiques décoratives et techniques des siècles passés, afin d’en faire valoir la richesse et souvent de dépasser les clichés apposés par les discours d’avant-garde sur le « décorativisme » de ces périodes. D’autre part, en parallèle de l’intérêt récent des éditeurs pour accueillir la parole des scénographes dans des ouvrages souvent richement illustrés (Richard Peduzzi, Yannis Kokkos par exemple), un important travail de réflexion sur la pratique de la scénographie contemporaine a émergé. Entre autres publications, notons les deux numéros successifs de la revue d’Études Théâtrales en 2012 qui se sont attachés à donner la parole aux scénographes, à mettre l’accent sur la qualité et la spécificité de leur geste et à questionner leurs relations avec le metteur en scène.
Les ouvrages consacrés au décor de cinéma, fortement ancrés dans des études historiques et techniques, suivent ces deux mêmes directions. Dès les années 1920, les chefs-décorateurs renommés prêtent une attention toute particulière à la bonne transmission de leur activité. Textes qui dépassent le simple exposé d’une pratique puisqu’ils interrogent le rôle du décor dans les films, tel l’ouvrage de Robert Mallet-Stevens, Le Décor moderne au cinéma (1928), où celui-ci décrit fidèlement les techniques de conception et propose parallèlement une esthétique pédagogique du décor de cinéma. Essai auquel on peut associer la somme Décor de films de Léon Barsacq (1970), L’Envers des décors de Georges Wakhévitch (1977) et l’étude illustrée de Max et Jacques Douy, Décors de cinéma (1993) ; ouvrages de référence, issus des premiers textes fondateurs, qui témoignent du désir des décorateurs de préserver leur histoire et leurs savoir-faire. Écrits qui offrent un aperçu précis de l’évolution du décor et ont aussi valeur de témoignage en réaction aux mutations techniques, industrielles et esthétiques contemporaines de leur publication. Quelques études plus récentes tels Les Chefs décorateurs (2000) de Peter Ettedgui, Le Décor au cinéma (2003) de Jean-Pierre Berthomé et Le Décor au cinéma (2008) de Françoise Puaux reviennent sur l’histoire du métier et sur l’évolution technique et esthétique des décors de cinéma. Tandis que des professionnels, tels Thierry Le Nouvel et Pascale Joanne Rabaud avec Chef décorateur pour le cinéma (2012) ou le décorateur italien Renato Lori pour Scénographie et réalisation des décors pour le cinéma (2016)[4], décrivent les tâches du décorateur dans le contexte actuel de réalisation des films. En dépit des avancées réalisées par ces ouvrages qui offrent un aperçu fidèle de la profession et de son histoire en interrogeant ses spécificités techniques, le travail des décorateurs et la pratique du décor en cinéma est encore un terrain de recherche à explorer et éclaircir. Réflexion attestée par l’émergence récente de plusieurs rencontres scientifiques consacrées aux métiers de la technique comme « Questions d’histoire des techniques et des métiers du cinéma et de l’audiovisuel », séminaire organisé par Kira Kitsopanidou et Sébastien Layerle (Université Sorbonne Nouvelle Paris 3) ou la première rencontre annuelle « Chercher/Créer » (janvier 2020), qui interroge la place de la technique et des technicien.nes dans la recherche en France, co-organisée par Baptiste Heynemann (Commission Supérieure Technique de l’Image et du Son), Giusy Pisano (École nationale supérieure Louis-Lumière) et Réjane-Hamus-Vallée (Université d’Evry Paris Saclay).
Dès lors, dans la continuité de ces recherches, nous souhaitons initier une étude du décor en cinéma et au théâtre à partir de trois principaux axes d’étude destinés à définir, illustrer ou questionner sa conception.
1° Étudier les décors et leurs métiers : sources et méthodologie Pour cet axe, il s’agira de revenir sur la méthodologie d’étude mais aussi de gestion des diverses ressources mises à disposition dans les fonds d’archives. Quelles sources avons-nous à disposition pour étudier les décors, de leur conception à leur recyclage, réemploi ou destruction ?
Bien souvent l’historien du théâtre ou du cinéma n’a pas accès aux décors eux-mêmes, mais seulement à des photographies, lithographies, maquettes, ou parfois encore seulement à des descriptions. Quelles sont les conséquences historiographiques de ce rapport au décor par sa miniature ou sa médiatisation ?
Il serait également pertinent de se pencher sur les ouvrages des décorateurs-auteurs – dont l’existence remonte au moins au traité de Nicola Sabbattini, Pratique pour fabriquer scènes et machines de théâtre (1638) – et dont les publications ne cessent jusqu’à nos jours. Souvent exploités comme sources d’informations, ces ouvrages méritent également d’être étudiés pour eux-mêmes : quel est le lectorat visé par ces ouvrages ? Comment mettent-ils en scène le dévoilement de l’envers du décor ? Quelle esthétique du décor cherchent-ils à défendre et participent-ils à imposer ?
Enfin, au-delà de la figure du chef d’atelier, du décorateur en chef ou de l’artiste scénographe, il nous apparaît nécessaire de se pencher sur les sources concernant tous les corps de métiers convoqués lors de la réalisation d’un décor. De quels autres corps de métier sont-ils issus ? Quels savoir-faire importent-ils dans les champs du théâtre et du cinéma ?
Pistes : sources de l’histoire des décors ; pratiques et gestion de conservation ; histoire et usage de la maquette au théâtre et au cinéma ; signalement et description de fonds inexploités ; les décorateursauteurs et leurs ouvrages ; les métiers de la construction du décor.
2° Construire l'illusion Mais quelle est la nécessité des décors ? Dès 1913, Jacques Copeau a annoncé son retour au « tréteau nu » et son renoncement à l’idée de décor. En 1986, Alain Cavalier et Bernard Evein démontrent avec Thérèse comment un film peut se passer de toute figuration réaliste des lieux jusqu’à remplacer les murs par des toiles de tissus. Mais la pratique du décor ne disparaît pas pour autant et le besoin de construire une réalité pour y installer une fiction reste prédominant. Si le caractère nécessaire du décor peut en lui-même faire l’objet d’une interrogation, le problème ouvre au questionnement des variations du rôle dramaturgique accordé à la décoration en fonction des esthétiques. Quelles que soient les variations formelles, le décor peut toujours, d’une certaine manière, être interrogé à travers la question de l’illusion : quel type d’illusion, c’est-à-dire quel pacte à la fois cognitif et émotionnel, le décor cherchet- il à produire ou au contraire à défaire, dénoncer, déplacer… ? N’assiste-t-on pas de nos jours, en particulier grâce à l’usage des projections vidéo, à un retour du réalisme sur les scènes contemporaines, confinant parfois à un renouveau de l’illusionnisme tant décrié dans les années brechtiennes ?
Il est en tous cas certain, dans les domaines du théâtre comme du cinéma, que la notion d’illusion gagne à être interrogée en liant les aspects techniques et dramaturgiques. Si nous nous concentrons sur la question de la fabrication de l’illusion, force est de constater que l’histoire du décor de cinéma dépend en partie de son rapport à l’artifice et de sa capacité technique à reproduire ou non ce qu’on considère comme « naturel ». Les grandes périodes du décor de cinéma sont justement définies à la fois à l’aune du développement des techniques employées destinées à renforcer l’illusion, à faire toujours plus « vrai », et selon une remise en question systématique et générationnelle de cette fidélité mimétique à la « nature » ou à la « réalité ». Il s’agit ainsi pour ce second axe d’étude d’interroger à nouveaux frais le décor et son rapport au réel.
Pistes d’études possibles : le décor « naturel », le décor en studio, l’illusion au fil des courants esthétiques (expressionnisme allemand, Société Albatros, néo-réalisme italien, Nouvelle Vague… ; naturalisme, symbolisme, brechtisme, tréteau nu ou espace vide…) ; le refus du décor
3° Transmission et interaction artistiques, culturelles et techniques des savoir-faire Pour ce dernier axe, nous proposons d’étudier les filiations entre les différents décorateurs et la nature de la transmission de gestes et pratiques de générations en générations. La construction des parcours professionnels mérite ainsi d’être étudiés dans leurs conséquences ; tout décorateur de cinéma a en effet d’abord été assistant avant de prétendre au poste de chef-architecte décorateur. Il s’agira, entre autres, de comprendre comment la personnalité du décorateur se renforce à l’aune de sa formation, d’interroger le partage du temps entre création et enseignement mais également l’influence des autres pratiques artistiques (art décor, design, peinture, arts plastiques, collaborations d'artistes…) dans la conception visuelle de spectacles ou films.
Pistes d’études possibles : Lazare Meerson ; Christian Bérard ; Jacques Saulnier ; Section décoration à l’IDHEC ; la transmission du savoir-faire dans les ateliers de décor des théâtres, hier et aujourd’hui ; les sections Scénographie à l’ENSATT, à l’école du TNS, à l’Académie de la Comédie-Française… (histoire, enseignants fondateurs, partis pris pédagogiques) ; disparition et recréation de savoir-faire
Les propositions d’articles, d’une longueur de 1500 à 2000 signes (espaces compris) accompagnées d’une présentation biobibliographique (800 signes maximum, espaces compris) doivent être envoyées avant le 15 septembre 2020 aux adresses suivantes : lea.chevalier@unicaen.fr / pierre.causse@unicaen.fr / valerie.vignaux@unicaen.fr
Les réponses seront adressées aux proposants le 1er octobre 2020 Les articles d’environ 30 000 signes seront à rendre pour le 15 janvier 2021.
Comité scientifique : Olivier Bara, PR, Université de Lyon-2, IHRIM - UMR 5317 Kira Kitsopanidou, PR, Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3 – IRCAV – EA 185 Giusy Pisano, PR, Louis-Lumière – IRCAV – EA 185
Double Jeu est la revue du département Arts du spectacle, de l’université de Caen-Normandie, https://journals.openedition.org/doublejeu/2277
Plutôt que de juxtaposer théâtre et cinéma, Double Jeu entend éprouver ces deux arts à des hypothèses, des problématiques, des regards qui leur soient communs, interroger l’un avec les concepts de l’autre et réciproquement ; et bien entendu se placer à leur articulation, là où des jonctions et des passerelles sont possibles, là où des frottements se font sentir, là où il y a du jeu.
Revue rattachée au LASLAR (Lettres, Arts du Spectacle, Langues Romanes – EA 4256) qui accueille chercheurs permanents et contributeurs occasionnels, afin d’instaurer entre les spécialistes des Arts du spectacle un dialogue aussi fructueux que celui qu’ont engagé depuis un siècle les praticiens et les créateurs.
Notes
1 Voir Marcel Freydefont, « Du décor à la scénographie », in Robert Abirached (dir.), Le Théâtre français du XXe siècle, Paris, L’Avant-Scène Théâtre, 2011, p. 613.
2 Françoise Puaux, Le Décor de cinéma, Paris, Cahiers du cinéma, 2008, p. 2.
3 Voir Denis Bablet Esthétique générale du décor de théâtre de 1870 à 1914, Paris, CNRS éditions, 1965.
4 Le même décorateur publie également Scénographie et réalisation des décors pour le théâtre en 2015, marque de la circulation des techniques, mais aussi de la nécessité de séparer les exposés pratiques.
Pistes bibliographiques
Domaine cinématographique
ALBERA François, Albatros. Des russes à Paris, 1919-1929, Paris/Milan, Cinémathèque française/Mazzotta, 1995.
AYROLLES Jacques et LEMERIGE Françoise, « Profession : chef décorateur », Cinémathèque Les Conférences du conservatoire des techniques cinématographiques, [en ligne] CANAL-U, 5 décembre 2014.
BARSACQ Léon, Le Décor de film : 1895-1969, Paris, H. Veyrier, 1985.
BERTHOME Jean-Pierre, Le Décor au cinéma, Paris, Cahiers du cinéma, 2003.
DOUY Max et Jacques, Décor de cinéma : un siècle de studios français, Paris Edition du Collectionneur, 2003.
ETTEDGUI Peter, Les Chefs décorateurs, Paris, La Compagnie du Livre, 2000.
LE NOUVEL Thierry et RABAUD Pascale-Joanne, Chef-décorateur pour le cinéma, Paris, Eyrolles, 2012.
LORI Renato, Scénographie et réalisation des décors pour le cinéma, Rome, Gremese, 2016.
MALLET-STEVENS Robert, Le Décor au cinéma, Paris, Nouvelles Éditions Séguier, Carré Ciné, 1996.
PISANO Giusy, Serge Pimenoff, https://www.cinematheque.fr/sites-documentaires/pimenoff/index.php
PUAUX Françoise, Le Décor au cinéma, Paris, Cahiers du cinéma, 2008.
TRAUNER Alexandre, Décors de cinéma, Paris, Jad/Flammarion, 1975. WAKHEVITCH Georges, L’Envers des décors, Paris, Robert Laffont, 1977.
Domaine théâtral
BABLET Denis, Esthétique générale du décor de théâtre de 1870 à 1914, Paris, Éditions du CNRS, 1965.
BOUCRIS Luc, DUSIGNE Jean-François et FOHR Romain (dir.), Scénographie, 40 ans de création, Montpellier, L’Entretemps, 2010.
BOUCRIS Luc, FREYDEFONT Marcel, LEMAIRE Véronique et SARTI Raymond (dir.), « Qu’est-ce que la scénographie ? Vol. II, Pratiques et enseignements », Études théâtrales, n°54-55, 2012/2-3.
BOURDIN Philippe et LE BORGNE Françoise (dir.), Costumes, décors et accessoires dans le théâtre de la Révolution et de l’Empire, Clermont-Ferrand, Presses universitaires Blaise-Pascal, 2010.
CHOLLET Jean, LEMAIRE Véronique et MAZLOUMAN Mahtab, Scénographes en France, 1975-2015 : diversité & mutations, Paris, Actes Sud, 2015.
CORNUAILLE Philippe, Les Décors de Molière 1658-1674, Paris, PUPS, 2015.
DANIELS Barry et RAZGONNIKOFF Jacqueline, Le Décor de théâtre à l’époque romantique : catalogue raisonné des décors de la Comédie-Française (1799-1848), Paris, Bibliothèque nationale de France, 2003.
FOHR Romain, Du Décor à la scénographie : anthologie commentée de textes sur l’espace scénique, Montpellier, L’Entretemps, 2014.
FREYDEFONT Marcel, « Du décor à la scénographie », in Robert ABIRACHED (dir.), Le Théâtre français du XXe siècle, Paris, L’Avant-Scène Théâtre, 2011, p. 613-648.
HAMON-SIREJOLS Christine, Le Constructivisme au théâtre, Paris, Éditions du CNRS, 1992.
JOIN-DIETERLE Catherine (dir.), L’Envers du décor : à la Comédie-Française et à l’Opéra de Paris au XIXe siècle, Montreuil, Gourcuff Gradenigo, 2012.
KOKKOS Yannis et BANU Georges, Yannis Kokkos, le scénographe et le héron, Arles, Actes Sud, 2004.
LEMAIRE Véronique et LESAGE Daniel, « Qu’est-ce que la scénographie ? Vol. I – Processus et paroles de scénographes », Études théâtrales, n°53, 2012/1.
LORI Renato, Scénographie et réalisation des décors pour le théâtre, trad. Valérie Pons, Saint-Denis-sur- Sarthon, Gremese, 2015.
PEDUZZI Richard, Là-bas, c’est dehors ; suivi de L’odeur du théâtre, Arles, Actes Sud, 2017.
SURGERS Anne, Scénographies du théâtre occidental, Paris, Armand Colin, 2017.
WILD Nicole, Décors et costumes du XIXe siècle. Tome I : À l’Opéra de Paris, Paris, Éditions de la Bibliothèque nationale de France, 2014.
WILD Nicole, Décors et costumes du XIXe siècle. Tome II : Théâtres et décorateurs, collections de la bibliothèque-musée de l’Opéra, Paris, Éditions de la Bibliothèque nationale de France, 2014.

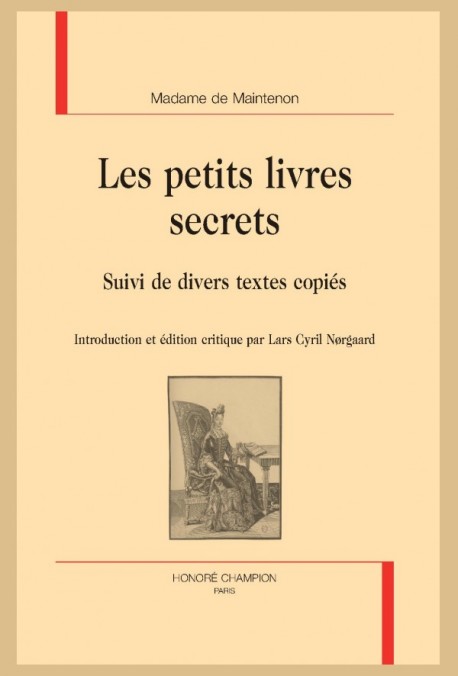 Madame de Maintenon, Les petits livres secrets. Suivi de divers textes copiés, introduction et édition critique par Lars Cyril Nørgaard, Paris, H. Champion, 2023.
Madame de Maintenon, Les petits livres secrets. Suivi de divers textes copiés, introduction et édition critique par Lars Cyril Nørgaard, Paris, H. Champion, 2023.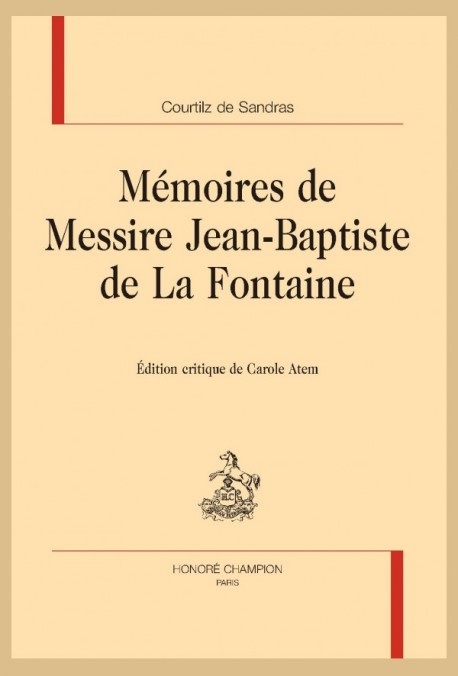 Courtilz de Sandras, Mémoires de Messire Jean-Baptiste de La Fontaine, édition critique de Carole Atem, préface de Jean-Paul Sermain, Paris, H. Champion, 2023.
Courtilz de Sandras, Mémoires de Messire Jean-Baptiste de La Fontaine, édition critique de Carole Atem, préface de Jean-Paul Sermain, Paris, H. Champion, 2023.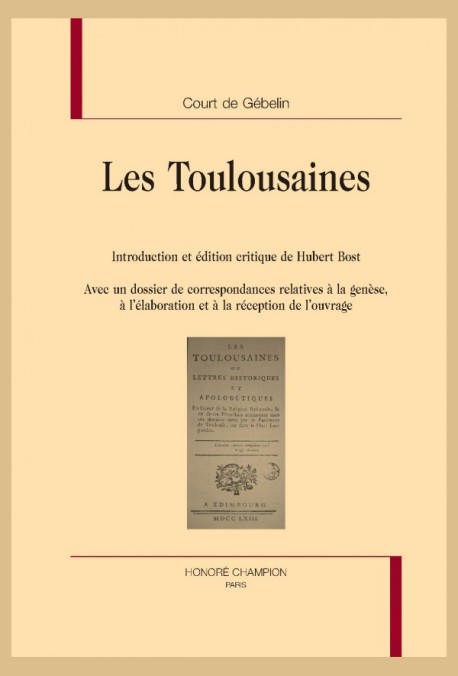 Court de Gébelin, Les Toulousaines, éd. Hubert Bost, Paris, H. Champion, 2023.
Court de Gébelin, Les Toulousaines, éd. Hubert Bost, Paris, H. Champion, 2023.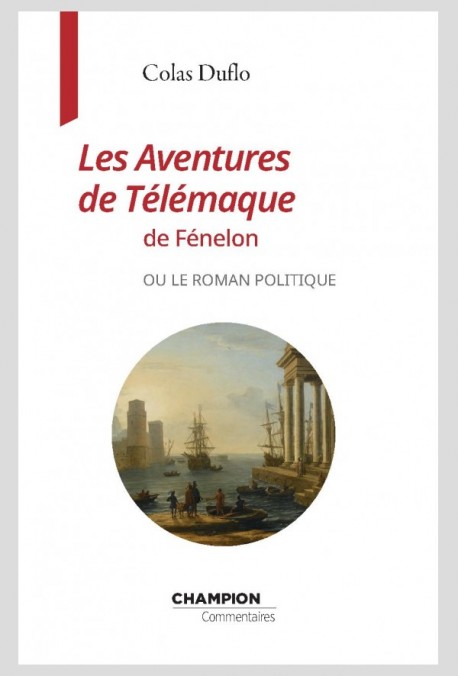 Colas Duflo, Les Aventures de Télémaque de Fénelon ou le roman politique, Paris, H. Champion, 2023.
Colas Duflo, Les Aventures de Télémaque de Fénelon ou le roman politique, Paris, H. Champion, 2023.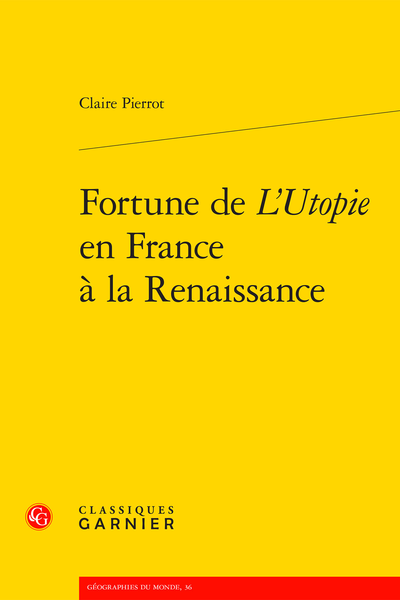 Claire Pierrot, Fortune de L’Utopie en France à la Renaissance, Paris, Classiques Garnier, 2023.
Claire Pierrot, Fortune de L’Utopie en France à la Renaissance, Paris, Classiques Garnier, 2023.