Journées d’études — 12 & 13 juin 2020
Faculté des Lettres de Sorbonne Université
Journées organisées par le comité scientifique de la Compagnie Sensible, avec le soutien de la Faculté des Lettres de Sorbonne Université, du Centre Roland Mousnier (UMR 8596, CNRS - Sorbonne Université) et de l’École nationale des Chartes.
Le séminaire « La Régence en fête (1715-1723) a reçu le parrainage de la Société d’étude du XVIIe siècle.
*
Prise entre deux longs règnes qui ont durablement marqué la mémoire collective, la Régence de Philippe d'Orléans (1715-1723) semble au premier abord être une parenthèse singulière dans l’histoire de France. Si elle fut l’occasion d’expériences politiques et économiques inédites, elle a été décrite dès la fin du XVIIIe siècle comme une période favorable au développement festif du libertinage. Cette image a fait fortune, à différents niveaux, chez les historiens et les érudits du XIXe siècle et du premier xxe siècle, jusque dans des œuvres cinématographiques et littéraires récentes qui se sont aussi accordées à la dépeindre comme une période de trouble moral et de plaisir enjoué ; en témoigne le célèbre film de Bertrand Tavernier, Que la fête commence ! (1975). La figure controversée du Régent elle-même a suscité de nombreux fantasmes, derrière les murs du Palais-Royal dont les « soupers » ont nourri l’imagination des pamphlets et des mémorialistes. L’esprit Régence aurait ainsi été un esprit de fête, aboutissement logique de la fin du règne de Louis XIV, pleine de rigueurs et de privations, et annonce naturelle de celui, abondant en richesses et en plaisirs, de Louis XV.
Puisque c'est par cette réputation de parenthèse licencieuse que la Régence est parvenue jusqu'à nous, il conviendrait de l’examiner au prisme de ses pratiques festives. C’est à cet examen que s’est attaché, pendant deux ans, le séminaire Régence en fête. Une telle approche est encouragée par les travaux qui, depuis trente ans et particulièrement depuis le début des années 2000, ont entrepris de renouveler notre regard sur la Régence sans toutefois consacrer à la fête un propos exclusif[1]. Elle invite par ailleurs à faire entrer dialogue les sources historiques, les œuvres littéraires et les réalisations artistiques, qui offrent sur la notion de fête des éclairages complémentaires.
Une telle réflexion se situe pour l’essentiel dans le sillage de trois grandes approches qui semblent guider les recherches en sciences humaines sur les pratiques festives :
La première, historique, s'intéresse à la façon dont la fête, qu'elle soit aulique ou publique, joue un rôle central dans la construction d'une symbolique au service d'un projet politique. Elle le fait à partir du foisonnement qu'a constitué la période révolutionnaire d'une part, et des festivités du règne de Louis XIV d’autre part.
La deuxième, plus littéraire, s'appuie notamment sur l'imaginaire du carnaval et fait une lecture de la fête comme temps de la subversion de l'ordre établi, de renversement des valeurs, de licence et de libération des corps.
Enfin, la troisième, anthropologique, met en avant les rapports de la fête avec le sacré ; moment de communion avec le divin, les fêtes sacrées jouent un rôle important dans l'organisation du temps et du travail dans la société chrétienne.
Ce que nous appelons fête recouvre dans la société d'Ancien Régime des réalités complexes. Ces trois approches permettent d’en rendre partiellement compte ; elles demandent non seulement à être croisées, mais aussi complétées par d’autres perspectives pour offrir un panorama le plus fidèle possible des expériences de la fête à l'orée du siècle des Lumières, dans toute leur pluralité et, bien souvent, dans leur coexistence – alors même que les historiens de la fête s'accordent à penser que le xviiie siècle est le temps d’un affadissement des fêtes dont la Régence aurait été la première étape.
Quels sont les aspects du quotidien de la Régence qui se révèlent à la lumière des traces laissées par les fêtes, tant religieuses que profanes ? Que peut-on y lire des rapports d'une époque à la sensualité, au plaisir, à un certain art de vivre ? Comment la fête imbrique-t-elle vie culturelle et vie artistique ? Quel visage du peuple français et de ses divisions sociales peut-on découvrir à travers elle, miroir partiel d'une époque où la France n'est pas encore révolutionnaire mais commence à interroger le modèle absolutiste ? Les récits des fêtes, et leur publication, ont-ils été porteurs d’enjeux dès la Régence, ou au cours de l’histoire ? Quelles méthodologies adopter pour rendre compte de pratiques n'ayant pas ou peu laissé de traces dans les archives ou les sources imprimées ?
Au-delà de ces aspects théoriques, c'est la question de la matérialité de la fête qui doit être interrogée ; les quelques années qui séparent 1715 de 1723 constituent un empan idéal pour observer les transitions et continuités qui articulent entre eux les XVIIe et XVIIIe siècles du point de vue des pratiques culturelles que recouvre le moment de la fête ; processions, musique, danse, architecture de la fête, habillement, nourriture.
Construction mémorielle complexe, objet de recherche invitant au croisement des disciplines, sujet historique encore peu exploré, la fête sous la Régence doit permettre aux chercheurs en histoire et en littérature, en musicologie et en histoire des arts, débutants ou confirmés, d'échanger pour tenter de reconstruire ensemble le portrait de cette époque dont bien des aspects restent encore méconnus. Les communications pourront s’intéresser, sans exclusive, aux thèmes suivants :
Mémoires et historiographie de la Régence : récits et légendes (XVIIIe-XXe siècles).
La Régence et ses fêtes (fêtes de cour, bal de l’Opéra, foires, fêtes dynastiques, etc.).
L’art de la fête dans le premier quart du XVIIIe siècle : permanences et ruptures.
Le problème des archives et la question des reconstitutions.
*
Les propositions de communication, d’une longueur maximale de 500 mots, sont à adresser jusqu’au 20 avril 2020, accompagnées d’une courte présentation bio-bibliographique, à Clément Van Hamme (clement.van_hamme@sorbonne-universite.fr) et Louise Noblet-César (louise.nobletcesar@hotmail.fr).
Les réponses seront données le 25 avril 2020, en vue d’une publication du programme définitif le 30 avril 2020.
UNE PUBLICATION DES ACTES EST ENVISAGÉE
_________
Organisation :
Alexandre Couturier (École nationale des chartes 2017)
Louise Noblet-César (École Normale Supérieure 2014)
Jean-Benoît Poulle (Sorbonne Université – CRM)
Clément Van Hamme (Sorbonne Université – CELLF)
_________
[1] Emmanuel Le Roy Ladurie, « Réflexions sur la Régence (1715-1723) », French Studies, XXXVIII, 3, 1984, p. 286-305 ; Topographie du plaisir sous la Régence. Études sur le XVIIIe siècle, 26, 1998 ; Le Régent. Entre fable et histoire, Paris, CNRS, 2003 ; Alexandre Dupilet, La Régence absolue. Philippe d'Orléans et la Polysynodie (1715-1718), Paris, Champ Vallon, 2011 ; Laurent Lemarchand, Paris ou Versailles ? La monarchie absolue entre deux capitales (1715-1723), Paris, CTHS, 2014.
http://egenceenfete.fr/appel-a-communications

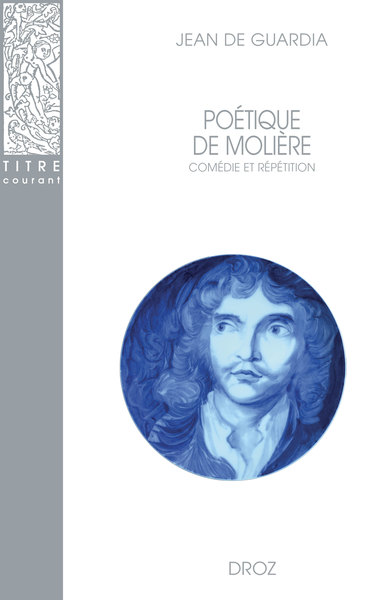 Jean De Guardia, Poétique de Molière : comédie et répétition (2e éd.), préface de Gilles Declercq, Genève, Droz, 2023.
Jean De Guardia, Poétique de Molière : comédie et répétition (2e éd.), préface de Gilles Declercq, Genève, Droz, 2023.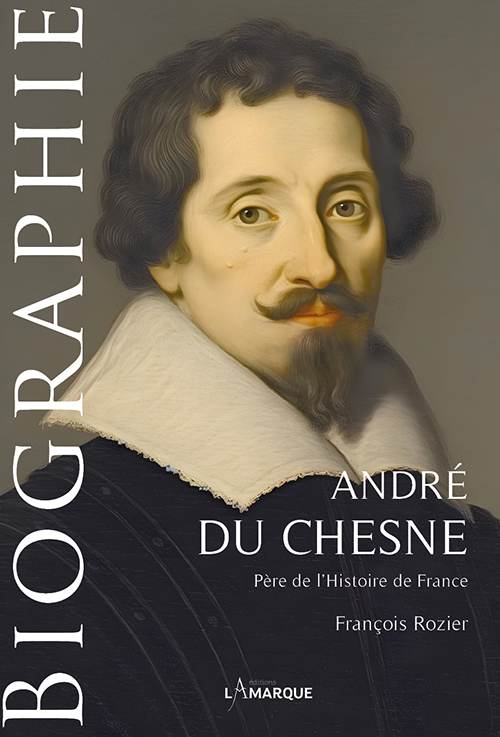 Nous avons retenu de la « République des Lettres » son éminent représentant Claude Fabri de Peiresc, mais nous avons oublié un de ses fidèles correspondants qui a, au moins à deux reprises, poursuivit des travaux commencés par le conseiller d'Aix (La publication des œuvres de Messire Guillaume du Vair et la controverse généalogique sur les origines mérovingiennes de la maison Habsbourg). André du Chesne (1584 – 1640), surnommé « Père de l'Histoire de France », aurait publié une centaine d'ouvrages. Cette première biographie rend hommage à l'historiographe du roi Louis XIII. C'est un outil indispensable pour mieux comprendre l'érudition de cette première moitié du XVIIe siècle. J'espère que vous accueillerez favorablement ce livre publié aux Éditions Lamarque (détails en PJ).
Nous avons retenu de la « République des Lettres » son éminent représentant Claude Fabri de Peiresc, mais nous avons oublié un de ses fidèles correspondants qui a, au moins à deux reprises, poursuivit des travaux commencés par le conseiller d'Aix (La publication des œuvres de Messire Guillaume du Vair et la controverse généalogique sur les origines mérovingiennes de la maison Habsbourg). André du Chesne (1584 – 1640), surnommé « Père de l'Histoire de France », aurait publié une centaine d'ouvrages. Cette première biographie rend hommage à l'historiographe du roi Louis XIII. C'est un outil indispensable pour mieux comprendre l'érudition de cette première moitié du XVIIe siècle. J'espère que vous accueillerez favorablement ce livre publié aux Éditions Lamarque (détails en PJ).