Paris (octobre 2020), Montréal (mai 2021).
Propositions : avant le 23 mai 2020
Nom de l’organisateur : Les Jaseuses
Email de l’organisateur : lesjaseuses.carnet@gmail.com
Site web de référence : https://lesjaseuses.hypotheses.org/685
Dans la scène d’ouverture du Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma, la peintresse Marianne, dans la France de la fin du XVIIIe siècle, enseigne à des jeunes femmes l’art du dessin – elle fait école. Par ce film, C. Sciamma déclare avoir cherché “des transmissions qu’on n’a pas eues”, l’héritage, par exemple, de l’artiste Marie-Gabrielle Capet dont elle s’inspire.
Les Jaseuses, collectif interdisciplinaire et international de recherche sur le genre, l’histoire des femmes* et de leurs créations, organisent en octobre 2020 (Paris) et mai 2021 (Montréal) un colloque en deux temps sur les “constellations créatrices”. Nous partons d’un constat : si nous sommes nombreux·ses à travailler sur des œuvres de femmes, parfois sur des œuvres de personnes dites queer (lesbiennes, bisexuelles, transgenres plus rarement…), il est fréquent de faire l’étude de ces créateur·ices en les isolant des réseaux d’autres femmes ou artistes queer – soit que nous souhaitions explorer leurs œuvres pour leur qualité intrinsèque, soit que nous craignions de trop particulariser voire essentialiser leurs parcours en les rattachant à des “œuvres de femmes”, à des “œuvres lesbiennes”, à des contre-cultures minoritaires en général (Wittig, 2011), soit encore parfois que nous ne sachions pas bien quels liens exactement ces œuvres tissent avec leurs propres “sous-champs” artistiques (Boisclair, 2004), faute de bien les connaître eux-mêmes. C’est à ce dernier problème que le colloque voudrait s’attacher.
Il va s’agir de réfléchir aux liens que les artistes de minorités de genre créent entre elles et eux – de poser leur existence, d’en sonder la nature, d’examiner leur importance dans la vie créatrice des personnes. Entendons par “minorités de genre” les femmes, à qui on a traditionnellement refusé l’accès aux domaines artistiques prestigieux, qu’on a rarement gratifiées quand malgré tout elles parvenaient à les investir (Nochlin, 1993), et toutes les personnes, peut-être plus invisibilisées encore ou dont en tout cas l’histoire reste à faire, qui n’ont pas pu s’identifier ni être identifiées dans l’histoire des arts comme des hommes. Leurs œuvres font rarement, ou trop peu, partie des canons traditionnellement enseignés. Malgré tout, l’effort “compensatoire” (Rennes, 2016) fourni par les chercheur·ses depuis les années 1970 et l’éclosion des études de genre a permis de mieux connaître les œuvres de femmes ou les œuvres de certaines contre-cultures : il est aujourd’hui relativement aisé de trouver des bibliographies fourmillantes d’informations sur les œuvres de femmes de telle ou telle période, sur la vie de telle ou tel artiste. Vient de paraître par exemple l’ouvrage de Geneviève Fraisse sur La Suite de l’Histoire, actrices, créatrices ; sans compter la somme encyclopédique que proposera en mars prochain Femmes et littérature (Reid, 2020).
Les réseaux, lignées ou constellations qui les relient sont souvent en revanche moins connus, à quelques exceptions près (les Précieuses par exemple). Il est pourtant nécessaire d’en faire l’histoire, sans quoi d’une part l’on manque tout un pan de la signification sociologique et politique de l’engagement des femmes et personnes queer en art, d’autre part l’on risque de négliger la valeur de leurs productions artistiques – le “champ” posant les conditions matérielles et symboliques de la reconnaissance de la valeur des œuvres (Bourdieu, 1992 ; Boisclair, 2004). Il faut donc se demander : comment ces personnes se sont-elles entraidées – ou au contraire, comment ont-elles vécu leur rivalité ? Quels sens politiques ont-elles donnés à leur rôle d’artistes, en tant que minorités ? Comment ont-elles négocié leur art entre place publique masculine et liens alternatifs qu’elles pouvaient construire entre elles ? Comment ont-elles envisagé la valeur de leurs œuvres, légitimées selon certaines instances – en particulier au sein de leurs réseaux quand ils existent –, illégitimes ailleurs ? Ce questionnement historique et sociologique des arts, centré sur les artistes et les liens qu’ils et elles entretiennent, doit être complété par une interrogation sur les œuvres elles-mêmes et des rapports d’intertextualité, d’inspiration et d’héritages qu’elles travaillent : comment se citent-elles entre elles ? Quelle place occupe la référence à d’autres œuvres dans leur genèse propre ? Quels imaginaires d’héritage ou d’influences sont sollicités, créent du sens ou de la valeur ?
Comme on le constate, différentes notions peuvent nous aider à théoriser ces liens entre artistes et entre œuvres, liens problématiques au sein d’une société et d’une tradition culturelle masculines. Il faut parler d'“héritages”, parce qu’il faut partir de l’une des questions centrales de l’histoire des arts : la transmission du maître à l’élève, dont l’importance est particulièrement grande dans les arts plastiques (les artistes qui exposent au Salon placent le nom de leurs maîtres à côté du leur, bénéficiant ainsi de leur prestige) – derrière cette transmission, la possibilité de faire école. L’ouvrage de Rozsika Parker et Griselda Pollock, Old mistresses : women, art, and ideology (1995), en cours de traduction, montre l’importance toujours fondamentale de cette question. Dans quelle mesure peut-on interroger un rapport de “maître·sse” à élève, quand on étudie les œuvres de femmes ou d’artistes queer ? Qu’est-ce qui est transmis dans ce cas : un savoir-faire, un habitus, des normes de genre, une forme d’engagement ? Les “maître·sses” sont-elles même reconnues comme telles par les personnes qu’elles ont effectivement formées ? Dans d’autres domaines artistiques, en littérature notamment, la transmission d’une génération à l’autre est plus floue : Christine Planté remarquait que la question de l’héritage entre femmes posait problème, car même quand il y avait bien une transmission de génération à génération (de livres, d’idées, mais aussi de structures d’accueil – revues, etc.), les “élèves” oublient ou ignorent parfois ce qu’elles doivent à leurs aînées et croient partir de zéro (Planté, 1985). Nous analyserons ce continuum féminin/queer en questionnant le degré d’intentionnalité qui préside à la constitution de ces filiations, gardant à l’esprit l’“effet palimpseste” théorisé par Audrey Lasserre (Lasserre, 2010).
La notion de “réseau” est également d’une grande importance : c’est elle qui nous permet de penser le “champ”, soit la toile qui se tisse entre différents “agents” d’un domaine artistique et établit les rapports de force, les valeurs, les règles de fonctionnement internes (Bourdieu, 1992). Les champs littéraires, cinématographiques ou artistiques traditionnels sont masculins et n’acceptent les femmes et personnes queer que de manière périphérique : même quand elles parviennent à créer, elles peinent à faire (re)connaître la valeur de leur œuvre au sein d’un champ qui ne les prend pas en considération. Les femmes, les personnes minorisées en général, ont pu se mettre elles-mêmes en réseau pour pallier ce problème, soit qu’il leur permît de construire une force collective et de s’imposer malgré tout dans le champ artistique dominant (comme l’Union des Femmes Peintres et Sculpteurs, fondée en 1881 par Hélène Bertaux), soit qu’il les autorisât à s’en extraire et à fonder leur propre “champ” ou “sous-champ” – Isabelle Boisclair en parlait pour les réseaux littéraires féministes qui se sont créés au Québec dans les années 1970 : “il s’agit […] d’une lutte pour l’obtention d’une valeur, d’un pouvoir, d’un capital.”
On peut également parler de “constellations”, et c’est le mot que nous choisissons de mettre en valeur dans ce colloque afin d’accentuer l’interrogation sur l’imaginaire des lignages, inspirations, héritages artistiques. Car il s’agit aussi d’envisager la place des filiations et sororités fantasmées, des réappropriations ou des rejets inventés, dans la création : que les figures tutélaires soient mythiques (Sappho, Eve, Lilith, Eurydice, Dibutade…) et/ou historiques (Marguerite de Navarre, Louise Labé, Lafayette, Sor Juana Ines de la Cruz, Dickinson, Sand, Plath…; Gentileschi, Vigée-Lebrun, Bonheur, Claudel, Kahlo, Bourgeois, Chicago… ; issues des différentes vagues des féminismes : Beauvoir, Wittig, Butler, Davis, Lorde, hooks, Solanas, Despentes, Preciado…). C’est aussi du point de vue de la recherche que l’on mène que ces lignages ou constellations fantasmées prennent sens : il y a une histoire à rattraper. Certaines œuvres de femmes ou d’artistes queer sont reçues comme des astres solitaires dans le ciel de la culture ; elles brillent, mais seules, et leurs créatrices sont perçues comme des exceptions dans leur époque. Les études de Michèle Riot-Sarcey, Eleni Varika et Christine Planté ont montré que cette notion d’exceptionnalité était à double tranchant : offrant une distinction à des artistes prétendument “hors-norme”, elle confirme la règle misogyne, et produit essentiellement exclusion et isolement. L’imagination qui rétablit le lien entre ces étoiles pour en faire des constellations s’amuse, inspire ; consacre les artistes, imaginant de nouvelles pléiades – Gretchen van Slyke parle de “constellation nourricière” (van Slyke, 1997). Mais ce travail imaginaire, qui repose en partie sur les affects des chercheur·ses (Alfonsi, 2019), permet aussi de former une connaissance réelle et fondée, souvent négligée sinon, sur l’art queer ; c’est l’objet du dernier ouvrage d’Isabelle Alfonsi qui, par un “travail généalogique” sur les lignées d’artistes queer, force à voir les liens qu’ils et elles ont véritablement entretenus, avec leurs contemporain·es, avec une histoire collective et politique de l’art qui les précédait et qu’ils et elles anticipaient en même temps. Le travail imaginaire sur les constellations féminines/ queer est un travail politique : il s’agit de transgresser les “filiations obligatoires” (Fraisse, 2018) et de “subvertir la tradition par son histoire même” (Fraisse, 2010).
Ces trois notions – héritage, réseau, constellation – serviront de guide pour construire ce colloque. Les propositions peuvent s’attacher à l’analyse de l’une d’elles, si elle apporte quelque chose à l’histoire des œuvres de femmes ou des artistes queer notamment sur un plan théorique ; il sera également envisageable de les manipuler ensemble pour examiner les particularités de certaines “constellations créatrices”, et les nuances qu’on peut apporter aux idées qui viennent d’être développées. Toutes les propositions sont bienvenues. Différents domaines artistiques peuvent être convoqués – peinture, cinéma, sculpture, littérature, danse, chant, bande-dessinée, performance, etc.
Modalités de soumission
Nous invitons les personnes qui souhaitent participer à nous indiquer où il leur sera le plus facile de se rendre, afin que nous puissions répartir les contributions : la première partie du colloque se tiendra à Paris les 9 et 10 octobre 2020, la seconde à Montréal les 21 et 22 mai 2021. Nous ne serons pas en mesure de prendre en charge les déplacements.
Contact : lesjaseuses.carnet@gmail.com
Date limite de proposition : 23 mai 2020.
Présentation d’environ 300 mots accompagnée d’une brève bio-bibliographie.
Le colloque devrait donner lieu à une publication en revue.
Bibliographie indicative
Isabelle Alfonsi, Pour une esthétique de l’émancipation : construire les lignées d’un art queer, éditions B42, Paris, 2019.
Juan Vicente Aliaga et Patricia Mayayo (dir.), Genealogías feministas en el arte español 1960-2010 / Généalogies féministes dans l’art espagnol 1960-2010 [cat. exp.], Madrid, This Side Up, 2013.
Saba Bahar et Valérie Cossy, Féminisme et littérature, Antipodes, Lausanne, 2003.
Shari Benstock, Femmes de la rive gauche : Paris, 1900-1940, Éditions des Femmes, Paris, 1987.
Karine Bergès, Florence Binard, et Alexandrine Nedelec-Guyard (dir.), Féminismes du XXIe siècle: une troisième vague ?, Presses Universitaires de Rennes, Rennes, 2017.
Marie-Joseph Bertini, Odile Gannier, Magali Guaresi, Barbara Meazzi, Francesca Sensini, Maria-Grazia Scimiari (dir.), “Simone de Beauvoir: réceptions contemporaines”, Les Cahiers Sens public, Lyon, n°25-26, septembre 2019.
Marie-Jo Bonnet, Les femmes artistes dans les avant-gardes, Éd. Odile Jacob, 2006.
Marie-Jo Bonnet, Liberté, égalité, exclusion : femmes peintres en Révolution, 1770-1804, Paris, Vendémiaire, 2012
Marie-Jo Bonnet, Les femmes dans l’art. Qu’est-ce que les femmes ont apporté à l’art ?, Paris, La Martinière, Coll. Patrimoine, 2004
Isabelle Boisclair, Ouvrir la voie/x: le processus constitutif d’un sous-champ littéraire féministe au Québec (1960-1990), éditions Nota bene, Québec, 2004.
Frances Borzello, A World of Our Own: Women as Artists, New York, Watson-Guptill, 2000
Pierre Bourdieu, Les Règles de l’art. Genèse et structure du champ littéraire, Seuil, Paris, 1998.
Terry Castle, The Apparitional Lesbian: Female Homosexuality and Modern Culture, Columbia University Press, New York, 1993.
Charlotte Foucher-Zarmanian, Créatrices en 1900 : femmes artistes en France dans les milieux symbolistes, Paris, Mare & Martin, 2015.
Luc Fraisse (dir.), Pour une esthétique de la littérature mineure, Champion, Paris, 2000.
Geneviève Fraisse, Les Femmes et leur histoire, Gallimard, Paris, (1998) 2010.
Geneviève Fraisse, journées d’études “Habiter la contradiction”, organisées par le collectif féministe les Vagues, la Fondation Ricard et l’Université de Paris-Diderot, 29-30 mars 2018. Citées dans Alfonsi, 2019.
Geneviève Fraisse, La Suite de l’Histoire. Actrices, créatrices, Seuil, Paris, 2019.
Tamar Garb, Sisters of the brush : women’s artistic culture in late nineteenth-century Paris, New Haven, Londres, Yale University press, 1994.
Catherine Gonnard et Élisabeth Lebovici, Femmes artistes, artistes femmes : Paris, de 1880 à nos jours, Paris, Hazan, 2007.
Susan Gubar, Sandra Gilbert, The Madwoman in the Attic, the Woman Writer and the Nineteenth-Century Literature Imagination, Yale university Press, New Haven, 1979.
Audrey Lasserre, “Histoire d’une littérature en mouvement : textes, écrivaines et collectifs éditoriaux du Mouvement de libération des femmes en France (1970-1981)”. Thèse de doctorat, Paris: Université de la Sorbonne Nouvelle – Paris III, 2014.
Audrey Lasserre (dir.), Y a-t-il une histoire littéraire des femmes ?, Fabula, LHT n°7, avril 2010.
Delphine Naudier, “La cause littéraire des femmes : modes d’accès et modalités de consécration des femmes dans le champ littéraire (1970-1998)”. Thèse de doctorat en sociologie. Paris: EHESS, 2000.
Linda Nochlin, Femmes, art et pouvoir et autres essais, Paris, Éditions Jacqueline Chambion, 1993.
Rozsika Parker et Griselda Pollock, Old mistresses : women, art, and ideology, Londres, Pandora Press, 1995.
Christine Planté, La Petite sœur de Balzac: essai sur la femme auteur, Presses Univ. de Lyon, 1985.
Christine Planté, “Quel compte fais-tu donc des femmes ?”, Romantisme, n°85, 1994, p. 67-78.
Diana Quinby, Le collectif Femmes/Art à Paris dans les années 70, une contribution à l’étude du mouvement des femmes dans l’art, Thèse dirigée par Françoise Levaillant, Histoire de l’Art et archéologie, Université Paris I, 2003
Martine Reid, Des femmes en littérature, Belin, Paris, 2010.
Martine Reid (dir.), Femmes et littérature. Une histoire culturelle, Gallimard, Paris, 2020.
Juliette Rennes (dir.), Encyclopédie critique du genre, éditions de La Découverte, Paris, 2016.
Adrienne Rich, La Contrainte à l’hétérosexualité et autres essais (1977-2007), Éditions Mamamélis et Nouvelles questions féministes, Genève, Lausanne, 2010.
Florence Rochefort, Histoire mondiale des féminismes, “Que sais-je ?”, Humensis, Paris, 2018.
Brigitte Rollet et Delphine Naudier (dir.), Genre et légitimité culturelle: quelle reconnaissance pour les femmes, L’Harmattan, Paris, 2007.
Lori Saint-Martin, Contre-voix. Essais de critique au féminin, Nuit blanche, Montréal, 1997.
Marina Sauer, L’entrée des femmes à l’école des beaux-arts : 1880-1923, Paris, ENSBA, 1991.
Gretchen van Slyke, “Portrait de l’artiste en femme” in Francis Ribemont (dir.), Rosa Bonheur (1822-1899) [cat. exp.], Musée des Beaux-Arts de Bordeaux / William Blake and Co. Edit., 1997, p. 76-83.
Séverine Sofio, Artistes femmes. La parenthèse enchantée XVIIIe-XIXe siècles, Paris, CNRS Editions, 2016.
Gayatri Chakravorty Spivak, “Can the Subaltern Speak?”, in Cary Nelson et Larry Grossberg (dir.), Marxism and the interpretation of Culture, 1988.
Perrine Vigroux, Les femmes à l’Académie royale de peinture et de sculpture (1663-1793) : sociabilité, pratique artistique et réception, sous la direction de Michèle-Caroline Heck, Thèse de doctorat, Montpellier, Université Paul Valéry, 2016.
Monique Wittig, La Pensée straight, Amsterdam, Paris, 2018.
Monique Wittig, Le Chantier littéraire, Presses Universitaires de Lyon, Lyon, 2011.
Virginia Woolf, A Room of One’s Own, Hogarth Press, London, 1929.

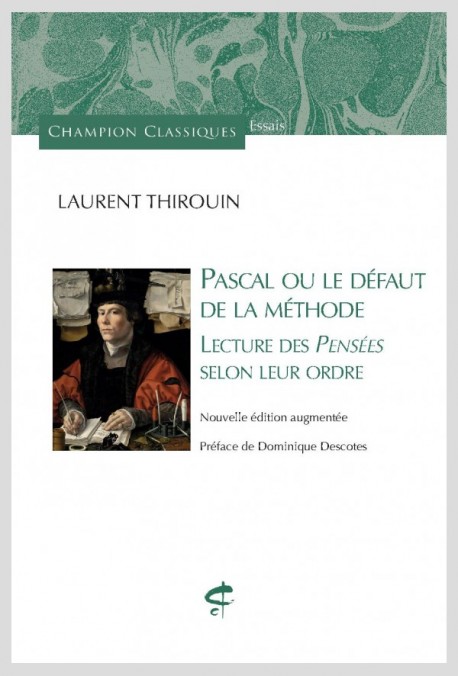 Laurent Thirouin, Pascal ou le défaut de la méthode. Lecture des "pensées" selon leur ordre, nouvelle édition augmentée, préface de Dominique Descotes, Paris, Honoré Champion, 2023.
Laurent Thirouin, Pascal ou le défaut de la méthode. Lecture des "pensées" selon leur ordre, nouvelle édition augmentée, préface de Dominique Descotes, Paris, Honoré Champion, 2023.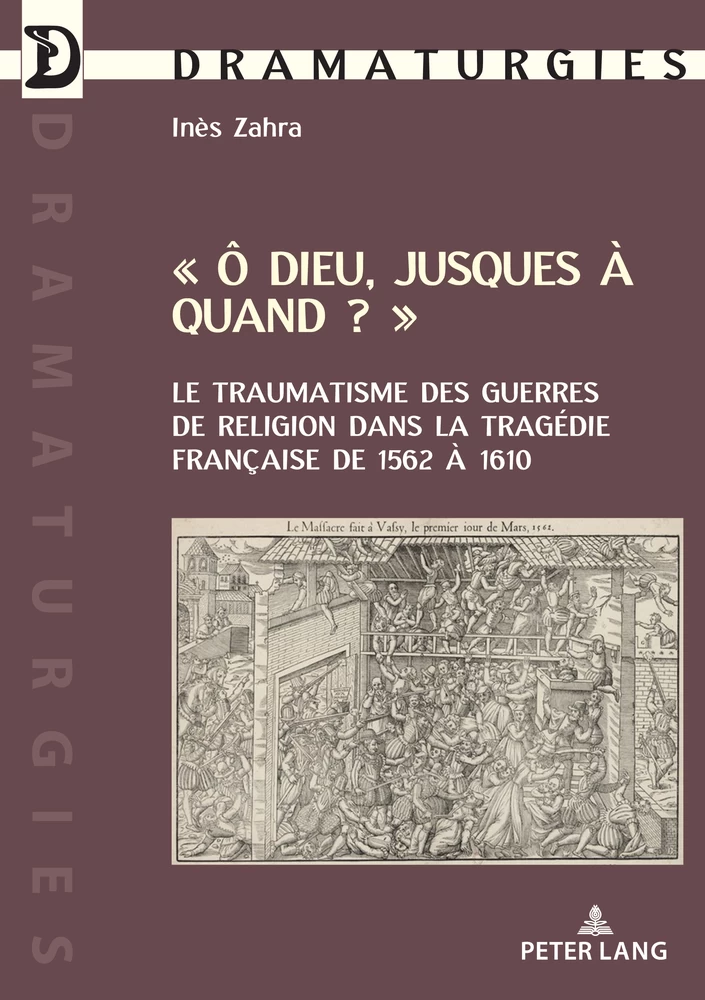 Agnès Zahra, Ô Dieu jusques à quand ? Le traumatisme des guerres de Religion dans la tragédie française de 1562 à 1610, Peter Lang, 2023.
Agnès Zahra, Ô Dieu jusques à quand ? Le traumatisme des guerres de Religion dans la tragédie française de 1562 à 1610, Peter Lang, 2023.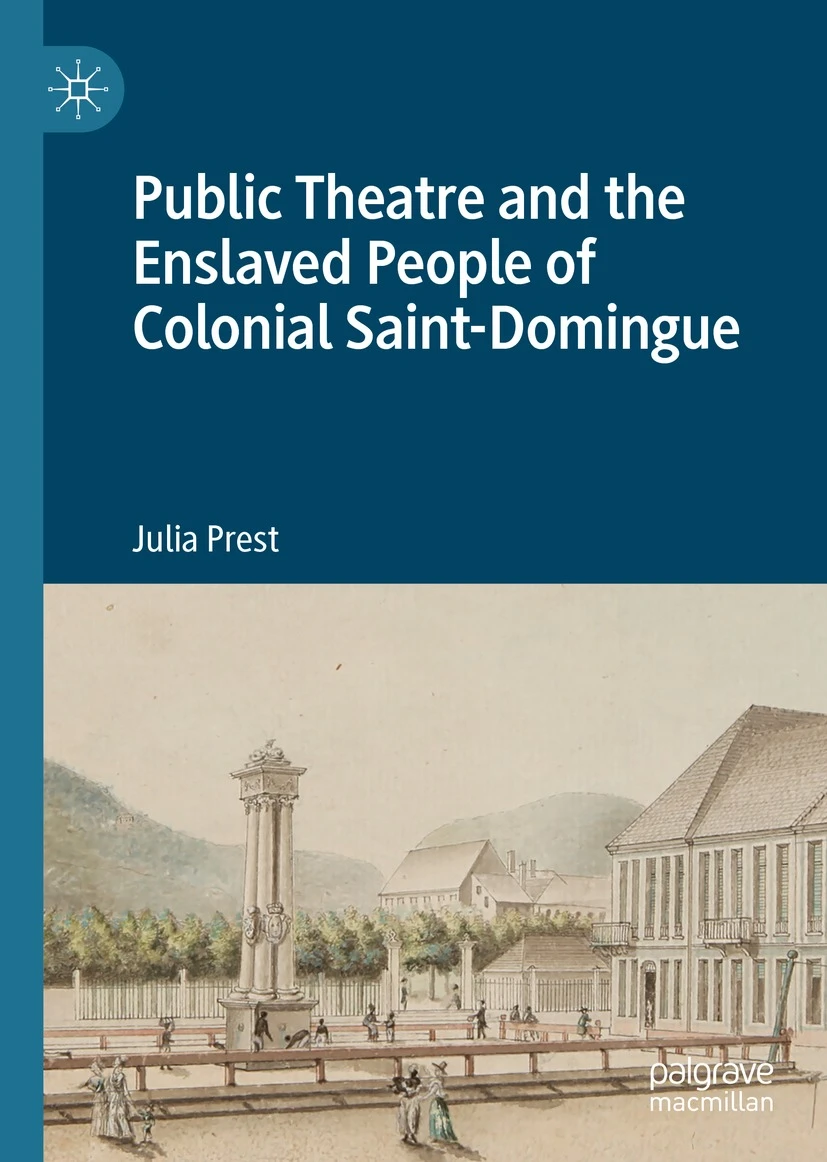 Julia Prest, Public Theatre and the Enslaved People of Colonial Saint-Domingue, London, Palgrave Macmillan, 2023.
Julia Prest, Public Theatre and the Enslaved People of Colonial Saint-Domingue, London, Palgrave Macmillan, 2023.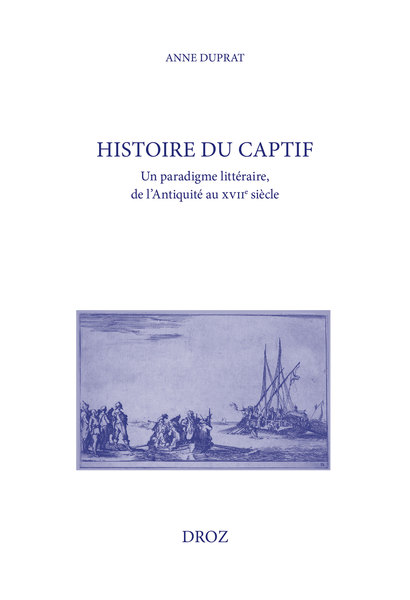 Anne Duprat, Histoire du captif. Un paradigme littéraire, de l'Antiquité au XVIIe siècle, Genève, Droz, 2023.
Anne Duprat, Histoire du captif. Un paradigme littéraire, de l'Antiquité au XVIIe siècle, Genève, Droz, 2023. Dans un passage de son Roman bourgeois (1666), Antoine Furetière prête à l’un de ses personnages le projet burlesque d’un livre intitulé Rubricologie, ou de l’invention des titres et rubriques, où il est montré qu’un beau titre est le véritable proxénète d’un livre. Le présent ouvrage prend au sérieux cette entreprise, pour comprendre ce que, durant le XVIIe siècle, le titre fait au livre et réciproquement.
Dans un passage de son Roman bourgeois (1666), Antoine Furetière prête à l’un de ses personnages le projet burlesque d’un livre intitulé Rubricologie, ou de l’invention des titres et rubriques, où il est montré qu’un beau titre est le véritable proxénète d’un livre. Le présent ouvrage prend au sérieux cette entreprise, pour comprendre ce que, durant le XVIIe siècle, le titre fait au livre et réciproquement.