5 septembre 2020.
La richesse de l’œuvre littéraire de Roger de Rabutin est désormais établie, qu’il s’agisse de son roman, de ses Mémoires ou de ses écrits épistolaires et poétiques ; cependant, ses réalisations figuratives, bien qu’elles soient tout aussi raffinées, sont moins connues, même si elles ont fait l’objet de plusieurs études.
Lors de son exil bourguignon, Bussy-Rabutin s’est attaché à la décoration de ses châteaux, Bussy et Chazeu. Il a notamment conçu un programme décoratif original pour orner plusieurs pièces du château de Bussy-le-Grand. Ce décor exceptionnel par son ampleur et par ses emprunts au genre de l’emblème suscite de nombreuses interrogations et appelle des approfondissements.
La journée d’étude organisée par la Société des amis de Bussy-Rabutin avec le concours du Centre Pluridisciplinaire Textes et Cultures de l’Université de Bourgogne Franche-Comté, sera consacrée aux emblèmes du château de Bussy-Rabutin et à leur inspiration. Elle s’inscrit dans le renouvellement récent des études sur l’emblème qui, au-delà du livre imprimé, envisagent à présent aussi l’influence de l’emblématique dans les arts du décor et même dans l’ensemble de la culture visuelle à l’époque moderne.
Plusieurs pistes pourront être explorées pour enrichir la connaissance de ce décor. Il s’agit d’abord d’approfondir son lien avec l’œuvre littéraire de Roger de Rabutin. Jeu aristocratique et jeu de l’esprit, la devise exigeait une parfaite maîtrise des arts de la conversation et de la pointe. Dans les maximes et les légendes piquantes qui agrémentent les portraits du château, Bussy-Rabutin donne la preuve de son goût pour ces pratiques. Élève des jésuites, il connaissait parfaitement les codes et le lexique de l’emblématique. Ses liens avec les pères Rapin et Bouhours sont également bien connus. Ce dernier a d’ailleurs évoqué dans ses Entretiens d’Ariste et Eugènele corps ou le mot de plusieurs devises que l’on retrouve au château de Bussy.
Enfin, une approche artistique est aussi particulièrement attendue. En effet, le contexte de production de ce décor – ou d’autres comparables – mérite d’être abordé. On pourra par exemple s’interroger sur les ateliers qui ont travaillé au château, sur les techniques employées, sur les liens entre les devises et les autres éléments du décor et plus généralement sur l’analyse iconologique des emblèmes. Les rapprochements avec d’autres décors français et européens demandent une attention particulière.
La journée d’étude se tiendra au château de Bussy-Rabutin le 5 septembre 2020.
Les communications, d’une durée de vingt-cinq minutes, seront publiées dans Rabutinages, la revue de la Société, avant le 31 décembre 2020.
Les propositions sont à adresser avant le 10 mai à :
Marie Chaufour : chaufour.marie7@gmail.com
et à :
Christophe Blanquie : ch.blanquie@outlook.com

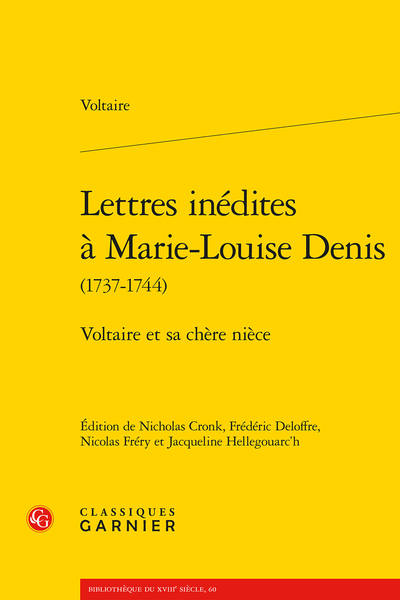 Lettres inédites à Marie-Louise Denis (1737-1744) Voltaire et sa chère nièce, éd. Cronk (Nicholas), Deloffre (Frédéric), Fréry (Nicolas), Hellegouarc'h (Jacqueline), Paris, Classiques Garnier, 2023.
Lettres inédites à Marie-Louise Denis (1737-1744) Voltaire et sa chère nièce, éd. Cronk (Nicholas), Deloffre (Frédéric), Fréry (Nicolas), Hellegouarc'h (Jacqueline), Paris, Classiques Garnier, 2023. Quel texte sous la musique ? Réflexion sur l’établissement des textes littéraires dans l’édition de la musique française sous le règne de Louis XIV, dir. Catherine Cessac, , Turnhout, Brepols, « MSRI 3 », 2022.
Quel texte sous la musique ? Réflexion sur l’établissement des textes littéraires dans l’édition de la musique française sous le règne de Louis XIV, dir. Catherine Cessac, , Turnhout, Brepols, « MSRI 3 », 2022. Jean de Marconville, De la bonté et mauvaistié des femmes, éd. Richard A. Carr, Paris, Classiques Garnier, (2000) 2023.
Jean de Marconville, De la bonté et mauvaistié des femmes, éd. Richard A. Carr, Paris, Classiques Garnier, (2000) 2023.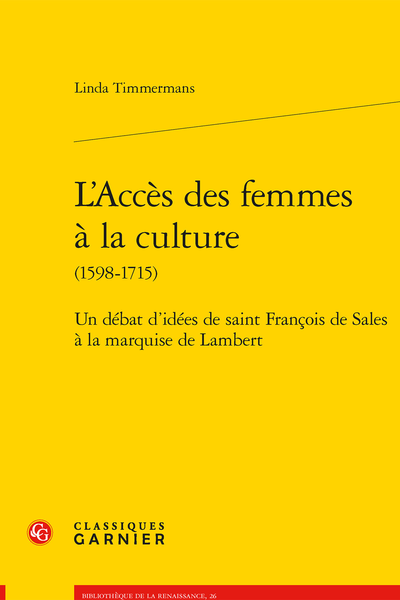 Linda Timmermans, L’Accès des femmes à la culture (1598-1715). Un débat d’idées de saint François de Sales à la marquise de Lambert, Paris, Classiques Garnier, (1993) 2023.
Linda Timmermans, L’Accès des femmes à la culture (1598-1715). Un débat d’idées de saint François de Sales à la marquise de Lambert, Paris, Classiques Garnier, (1993) 2023.