organisé par le Centre de recherche du château de Versailles
le 17, 18 et 19 juin 2021
Au sortir de l’âge féodal, les cours royales et princières constituent un phénomène européen à contenu politique, social et culturel : monopolisation du pouvoir au profit d’un seul, rassemblement d’un groupe d’individus autour du souverain et de sa famille (princes, courtisans, officiers des maisons domestiques et militaires), développement d’une sociabilité et d’un mode de vie spécifiques, rythmés par le cérémonial, la recherche de l’ostentation et les divertissements. Ces cours sont aussi nombreuses et diversifiées que les dynasties qui sont à leur tête ; néanmoins, certaines acquièrent une valeur normative, comme la cour de Bourgogne au XVe siècle ou les cours italiennes au XVIe siècle. Au XVIIe et plus encore au XVIIIe siècle, c’est la cour française des Bourbons, en particulier celle de Louis XIV, qui tend à prendre valeur d’archétype : à partir d’une réalité vue et vécue par les contemporains des rois de France, se construit un imaginaire qui travaille longtemps les monarchies européennes, jusqu’à la disparition de la majorité d’entre elles au début du XXe siècle, alors même que les configurations politiques changent, allant du partage du pouvoir avec les assemblées à l’instauration de républiques.
Les deux éléments contradictoires mais complémentaires qui caractérisent l’idée de mythe – le réel et la reconstruction du réel – trouvent, dans le cas français, leur incarnation la plus aboutie à Versailles. À la fois espace royal, mode de gouvernement et formation sociale, Versailles est une formulation architecturale, administrative et spectaculaire du pouvoir « absolu » associé à la figure de Louis XIV. L’objectif du programme « Identités curiales et le mythe de Versailles en Europe : perceptions, adhésions et rejets (XVIIIe-XIXe siècles) », que viendra clore ce colloque, est d’analyser le modus operandi de ce mythe de Versailles dans l’Europe monarchique des XVIIIe et XIXe siècles. Deux questions fondamentales doivent alors être posées : comment l’imaginaire suscité par Versailles auprès des contemporains qui ont fréquenté la cour sous l’Ancien Régime, puis des visiteurs venus au XIXe siècle, s’est-il élaboré et en quoi consiste-t-il ? Et dans un mouvement de réciprocité, comment cet imaginaire a-t-il pu se mettre en œuvre dans les cours d’Europe, avec toutes les nuances possibles, allant de l’imitation au rejet en passant par la simple adhésion ? L’enjeu de ce colloque sera donc double : cerner comment les différents aspects propres à l’identité de Versailles ont pu nourrir un imaginaire, mais aussi saisir la manière dont cet imaginaire a pu susciter d’autres réalisations – architecturales, rituelles, politiques.
Axes du colloque
1. La production du mythe, du réel à l’imaginaire : création, mutations, contestations (XVIIe-XIXe siècles)
Le mythe de Versailles s’est diffusé dans l’Europe des cours jusqu’à ce que la civilisation curiale disparaisse au début du XXe siècle. Il s’est constitué à travers les récits de toutes sortes laissés par les visiteurs étrangers qui ont établi un rapport personnel avec la cour des Bourbons, que ce fût en contemporains témoins directs du Versailles royal jusqu’en 1789, ou en curieux des vestiges d’un temps disparu, mus par tout une gamme de sentiments, de la nostalgie à la vitupération. Ce mythe se construit sur le mode de l’imaginaire, nourri d’une réalité observée ou fantasmée. Il diffère du discours historique à la posture objective : c’est de la subjectivité du « visiteur » que nait le mythe.
En octobre 2019, le Centre de recherche du château de Versailles a mis à disposition parmi ses ressources en ligne une base de données intitulée « Visiteurs de Versailles ». L’un des objectifs du colloque sera d’exploiter ce corpus, selon diverses modalités :
Une approche chronologique :
- Impressions sur le Versailles royal : contemporains du premier Versailles de Louis XIV, évolutions du regard sous Louis XV puis sous Louis XVI et Marie-Antoinette, prenant en compte l’héritage louis-quatorzien mais aussi les changements opérés dans le mode de vie curial et l’aménagement des espaces (travaux dans le parc, retraite au Petit Trianon, création d’un jardin à l’anglaise, etc.).
- Versailles vu après la Révolution : pendant l’Empire, pendant la Restauration et en particulier pendant la Monarchie de Juillet, période charnière marquant le passage de l’imaginaire à l’histoire avec l’édification du musée de l’Histoire de France par Louis-Philippe et la littérature qui l’a accompagnée (Alexandre de Laborde, etc…).
Une approche sociologique :
Saisir qui sont les acteurs ayant participé à l’élaboration du mythe et en ayant été le vecteur. Pour comprendre leurs attentes et leurs points de vue, la réflexion pourra se décliner autour des différents critères qui forgent l’identité propre des visiteurs : leurs origines géographiques, leur appartenance sociale, leur langue mais aussi leur culture politique, religieuse ou nationale.
Une approche thématique :
- Éléments de cérémonial le plus souvent observés : le lever/le coucher, les repas en public, la messe, le parcours du roi et de la famille royale entre ces différents moments, mais aussi les fêtes et divertissements…
- Les lieux qui retiennent particulièrement l’attention : les façades du château, la Grande galerie, les Chambres du roi et de la reine, les Grands appartements, la chapelle, l’opéra, le Petit et le Grand Trianon, les jardins et leurs bassins.
- Les éléments plus généraux que les visiteurs associent systématiquement à Versailles : système hydraulique et machine de Marly, pompe et dépenses somptuaires, vanité des rois de France et idolâtrie de leurs sujets, Marie-Antoinette et sa vie champêtre à Trianon ou encore, après 1789, les conséquences de la Révolution (dégradations, pillages, ventes, départ de la famille royale pour Paris).
2. Les applications du mythe, de l’imaginaire au réel : réception et aléas du paradigme de Versailles (XVIIIe-XXe siècles)
Le second axe de recherche proposé a pour but de comprendre l’efficience de cet imaginaire de Versailles. En reliant le mythe, tel qu’il a pu être fabriqué par les visiteurs, aux réalisations auxquelles il a pu donner lieu, il s’agira de comprendre comment un « modèle » travaille et peut (ou non) devenir opératoire. Nous souhaitons ainsi examiner l’impact que Versailles a eu dans l’Europe des cours, en mettant en parallèle la conduite et l’organisation de ces cours avec le ressenti de leurs ressortissants vis-à-vis du paradigme versaillais. En ce sens, devront être cernées ces façons dont Versailles a été vécu, transcrit, valorisé, dénigré, accepté, copié ou réfuté : comment le mythe se réalise-t-il ? A-t-il pu innerver des pratiques et des créations, participer à l’élaboration d’un esprit européen et cosmopolite, tout en étant à la fois admiré et détesté ? Et si tel est le cas, quelles pouvaient en être les motivations : pourquoi s’inspirer de Versailles ou au contraire le rejeter, voire rester indifférent ?
Toutefois, il ne s’agit pas de susciter une étude comparative, point par point, entre un « modèle » et ses éventuelles « imitations » qui proposerait seulement de confronter des données factuelles. Au contraire : plutôt que d’envisager la question sous l’angle de l’influence, nous la considérerons sous l’angle des interactions, afin de saisir l’articulation entre un imaginaire et ses applications concrètes dans l’architecture, l’organisation curiale, les pratiques sociales et artistiques (cérémonial, danse, théâtre, musique). L’objectif est de comprendre les logiques, les motivations et les enjeux sous-jacents qui ont présidé à ces dynamiques d’appropriation : pourquoi dans certains cas s’appuyer sur Versailles plutôt que sur des modèles concurrents, et à l’inverse, pourquoi dans d’autres cas privilégier des tendances antagonistes au paradigme versaillais ? Il faudra également veiller à distinguer cette question de celle d’un « modèle français » plus global : quels sont les éléments que l’on retient de la cour versaillaise spécifiquement ?
Seront particulièrement recherchées les propositions qui examineront les cours européennes au XVIIIe siècle et plus encore au XIXe siècle, à l’heure où Versailles perd justement sa vocation initiale. Nous recherchons notamment des études portant sur les thématiques suivantes :
Les modalités et les enjeux des variations sur le thème de Versailles, comme à Lunéville, Caserte ou Herrenchiemsee.
L’héritage de Versailles en France, dans les cours impériales et dans le fonctionnement protocolaire de la Troisième République.
La place du mythe de Versailles sur l’échiquier européen du long XIXe siècle, en particulier auprès des monarchies récentes : royaume belge (1831), royaume grec (1833), royaume d’Italie unifié (1861), royaume roumain (1881), royaume bulgare (1908), royaume monténégrin (1910), entre autres. Le XIXe siècle est le véritable siècle des cours, dont la multiplication va de pair avec le mouvement des nationalités. C’est aussi celui de la prégnance de nouveaux « modèles » – prussien et russe, notamment – auxquels Versailles pourra être confronté.
*
Pour participer
Les propositions de communication sont à envoyer à l’adresse flavie.leroux@chateauversailles.fr, avant le 31 octobre 2020. Elles devront comprendre, en 5000 signes maximum, le titre de la communication, le contenu de la proposition (questionnements, méthode employée, sources mobilisées), quelques éléments biographiques et les coordonnées du candidat. Ces propositions de communication seront examinées par le comité d’organisation et le comité de pilotage. Les candidats recevront une réponse quant à leur participation au colloque d’ici la fin du mois décembre 2020.
*
Comité d’organisation
Gérard Sabatier, professeur émérite de l’université de Grenoble II, chef de projet pour le programme « Identités curiales et le mythe de Versailles en Europe : perceptions, adhésions et rejets (XVIIIe-XIXe siècles) »
Mathieu da Vinha, directeur scientifique du Centre de recherche du château de Versailles
Flavie Leroux, attachée de recherche au Centre de recherche du château de Versailles pour le programme « Identités curiales et le mythe de Versailles en Europe : perceptions, adhésions et rejets (XVIIIe-XIXe siècles) »
Comité de pilotage
Antonio Álvarez-Ossorio, Universidad Autónoma de Madrid,
Maciej Forycki, Uniwersytet Adam Mickiewicz, Poznań,
Mark Hengerer, Ludwig-Maximilians-Universität, Munich,
Christine Jeanneret, Centre de recherche du château de Versailles et Danish National Museum, Frederiksborg, Danemark,
Jean-Marie Le Gall, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
Francine-Dominique Liechtenhan, Centre national de la recherche scientifique,
Philip Mansel, The Society for Court Studies, président du GIP-CRCV,
Andrea Merlotti, Centro Studi La Venaria Reale,
Friedrich Polleroß, Universität Wien,
José Luis Sancho Gaspar, Patrimonio Nacional, Madrid,
Marie-Christine Skuncke, Uppsala Universitet,
Jonathan Spangler, Manchester Metropolitan University,
Thomas W. Gaehtgens, Getty Research Institute, Los Angeles.
http://chateauversailles-recherche.fr/francais/colloques-et-journees-d-etudes/appels-a-communication/appel-a-communication-pour-le-colloque-le-mythe-de-versailles-et-l-europe-des-1083.html

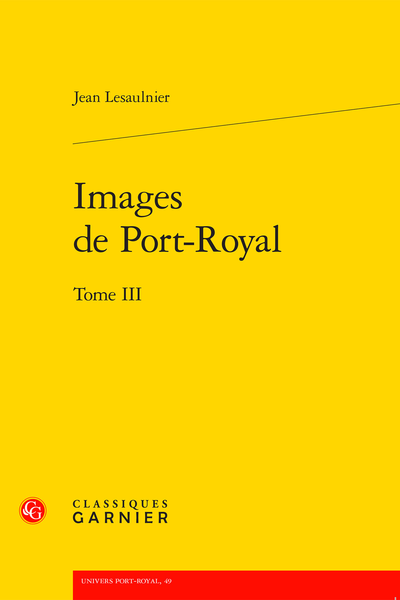 Jean Lesaulnier, Images de Port-Royal. Tome III, Paris, Classiques Garnier, 2022.
Jean Lesaulnier, Images de Port-Royal. Tome III, Paris, Classiques Garnier, 2022.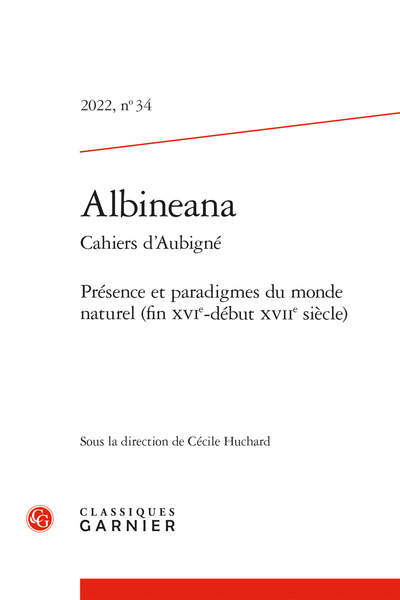 Albineana, 2022, n° 34 : "Présence et paradigmes du monde naturel (fin XVIe-début XVIIe siècles)"
Albineana, 2022, n° 34 : "Présence et paradigmes du monde naturel (fin XVIe-début XVIIe siècles)"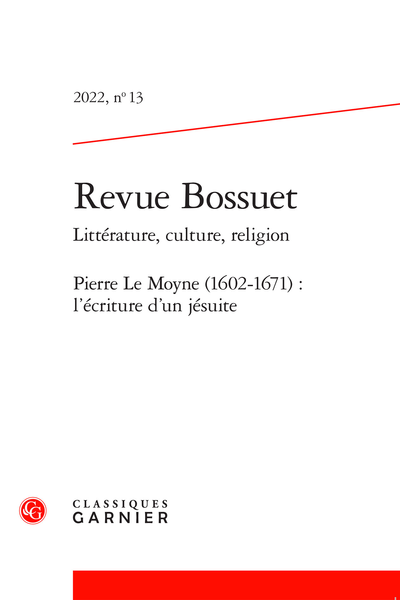 Revue Bossuet, 2022, n° 13 : "Pierre Le Moyne (1602-1671) : l’écriture d’un jésuite"
Revue Bossuet, 2022, n° 13 : "Pierre Le Moyne (1602-1671) : l’écriture d’un jésuite" Julien Offray de La Mettrie, L’Homme-machine, éd. Solange Gonsalez, Paris, Classiques Garnier, 2023.
Julien Offray de La Mettrie, L’Homme-machine, éd. Solange Gonsalez, Paris, Classiques Garnier, 2023.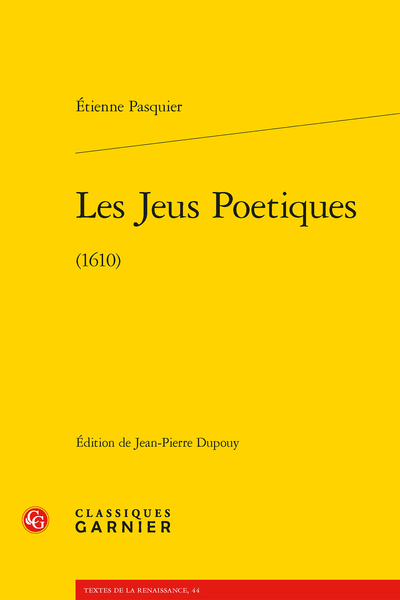 Etienne Pasquier, Les Jeus Poetiques (1610), éd. Jean-ierre Dupouy, Paris, Classiques Garnier, (2001) 2023.
Etienne Pasquier, Les Jeus Poetiques (1610), éd. Jean-ierre Dupouy, Paris, Classiques Garnier, (2001) 2023.