Vendredi 6 mars 2020
EA 4398 PRISMES / PEARL/ Epistémè
Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3
L’essor de l’histoire du livre et de la lecture d’une part, et le material turnde la critique anglo-américaine d’autre part, ont invité les chercheurs à mieux prendre en compte l’importance de la dimension matérielle des écrits à la période moderne, qu’ils soient imprimés ou manuscrits, ainsi que le rôle de leur inscription dans l’espace public ou privé. Dans la lignée de ses travaux sur l’imbrication entre littérature et culture matérielle, l’équipe PEARL/Epistémè souhaite engager une réflexion sur les rapports entre la matérialité des textes et leur définition générique dans l’Europe de la première modernité.
On s’intéressera ainsi dans un premier temps au roman pastoral, genre qui connaît un grand succès partout en Europe aux seizième et dix-septième siècles. Il s’inscrit plus largement dans le « mode » pastoral, ainsi nommé en raison de la souplesse formelle et stylistique qui lui permet de faire se côtoyer et bien souvent se mêler poésie, théâtre, prose, inspirations musicale et picturale. Plus encore que les autres genres pastoraux, le roman se caractérise par une hybridité générique qui se traduit par l’insertion de nombreux poèmes grâce auxquels l’auteur(e) teste et exhibe ses talents poétiques, mais aussi de lettres, de messages codés ou cryptiques, etc. L’inscription matérielle du texte par la mise en abyme de ces écrits insérés se trouve redoublée ou prolongée par leur histoire éditoriale, en particulier par l’ajout de « clefs » identifiant les personnages fictifs à leurs « référents » supposés à la cour, qui bien souvent ne sont pas de la main de l’auteur(e). Lorsque les éditions et rééditions se succèdent, les romans peuvent même intégrer les traces de leur propre réception, grâce à l’ajout d’annexes ou de fins venant se substituer à celles absentes, lorsque – ce qui est souvent le cas (L. Plazenet) – l’auteur(e) n’a pu ou voulu terminer l’œuvre de manière explicite. Comme pour l’Arcadiede Philip Sidney en Angleterre, certaines éditions grandissent ainsi jusqu’à inclure plusieurs fins alternatives, tandis que d’autres auteur(e)s choisissent de publier indépendamment la leur (A. Weamys, 1651), à moins qu’il ne s’agisse de l’adaptation/réécriture d’un épisode précis du roman sur la scène (par exemple The Isle of Gullsde John Day, 1606). À travers ces multiples métamorphoses, le roman pastoral transcende régulièrement les bornes de son propre texte.
Les frontispices et illustrations, mais aussi les références à des œuvres picturales, qui peuvent se transformer en véritables ekphraseis, jouent un rôle majeur pour plonger le lecteur/la lectrice dans l’atmosphère d’otiumpropre à la pastorale, ou au contraire suggérer sa fragilité. L’imbrication entre littérature et peinture est telle que si les auteur(e)s peuvent faire allusion à des œuvres existantes voire célèbres, des artistes dépeignent à leur tour les passages les plus mémorables de ces œuvres. La musique y occupe également une place prépondérante : il n’est pas rare que des poèmes évoqués comme étant chantés dans le contexte fictionnel – à la suite de l’Arcadiede Sannazar, dont la structure met en miroir églogues et descriptions en prose – soient par la suite mis en musique. Ils entretiennent ainsi la fascination exercée par l’« imaginaire pastoral », et son emprise sur un réel bien moins idyllique.
À travers ces « ponts » jetés entre fait et fiction, le roman pastoral accroît son influence culturelle, notamment dans les « salons », dont l’émergence est concomitante voire légèrement postérieure au succès de ce genre. L’esthétique du mélange qui le caractérise n’est en effet pas sans rappeler celle de la culture des salons où se succèdent moments de conversation, de lecture, jeux d’esprit, découverte d’objets nouveaux et d’artéfacts en tous genres. De tels objets écument aussi la pastorale, qu’il s’agisse des accessoires emblématiques des bergers, comme la houlette, la panetière ou la couronne de fleurs, ou bien de livres mystérieux, de miniatures, de reliques d’un ancien amour. Suscitant l’engouement et la curiosité, ces objets traversent librement les frontières du réel et de la fiction pour trouver leur réplique dans la « vraie vie », notamment dans la mode, l’architecture ou l’art des jardins. Texte et monde réel semble alors tenir en partage une même culture matérielle qui brouille d’autant mieux leurs frontières réciproques. Partant de la « chose littéraire » et des formes qu’elle revêt, cette étude des « matières pastorales » vise donc à s’étendre bien au-delà afin d’explorer la mutuelle imbrication de l’écriture et de la culture matérielle.
Quelques pistes de réflexion, non exhaustives :
Le choix d’une circulation manuscrite et/ ou d’une publication imprimée ;
l’histoire éditoriale du/ des romans ;
l’hybridité générique des romans ;
les adaptations picturales, musicales ou théâtrales ;
le rôle des circulations européennes ;
la « fan fiction » pastorale, c’est-à-dire les réponses, suites ou fins alternatives, ou bien les marginalia, rédigées par des lecteurs / lectrices anonymes ou non ;
la perméabilité entre « réalité » et fiction, notamment par le biais des « clefs » ;
la revendication ou la critique du roman pastoral comme genre « féminin » ;
la mise en scène de l’écriture et le rôle de la réécriture dans les romans.
Les approches comparatistes mettent en lumière la dimension européenne de la pastorale sont encouragées.
Les interventions, de préférence en français, n’excéderont pas vingt minutes. Les propositions de communication, de 300 mots environ, peuvent être envoyées à l’adresse suivante pour le 30 octobre 2019: aurelie.griffin@sorbonne-nouvelle.fr
Une réponse sera communiquée pour le 15 novembre.
*
Bibliographie sélective:
Brayman Hackel H., Reading Material in Early Modern England : Print, Gender, and Literacy, Cambridge, CUP, 2005.
Brayman H., J. Lander et Zachary M. Lesser (dir.), The Book in History, The Book as History : Essays in Honor of David Scott Kastan, Ithaca, Yale UP, 2016.
Chartier R., Culture écrite et société. L’ordre des livres (14e-18esiècles), Paris, Albin Michel, 1996.
Chartier R., « Lectures et lecteurs ‘populaires’ de la Renaissance à l’âge classique », in G. Guglielmo et R. Chartier, Histoire de la lecture dans le monde occidental, Paris, Seuil, 2001 [1997], p. 337-354.
Dandrey P. et D. Denis (dir.), De la polygraphie au dix-septième siècle, Paris, Honoré Champion, 2003.
Denis D. (dir.), Lire L’Astrée, Paris, PUPS, 2008.
Duval S., La Prose poétique du roman baroque, 1571-1670, Paris, Classiques Garnier, 2017.
GiavariniL., « Représentation pastorale et guérison mélancolique au tournant de la
Renaissance : questions de poétique », Études Épistémè, n° 3, 2003, p. 1-27.
Giavarini L., La Distance pastorale : usages politiques de la représentation des bergers (XVIe-XVIIe siècles), Paris, Éd. de l’EHESS, 2010.
Irigoyen-Garcia J., The Spanish Arcadia : Sheep Herding, Pastoral Discourse, and Ethnicity in Early Modern Spain, Toronto, U of Toronto P, 2013.
Lallemand, M.-G., « Les poèmes d’Honoré d’Urfé insérés dans l’Astrée », Dix-septième siècle/2, n°235, p. 295-313.
Lallemand, M.-G., La Lettre dans le récit : étude de l’œuvre de Mlle de Scudéry, Tübingen, Gunter Narr Verlag, 2000.
Lallemand, M.-G., Les Longs Romans du dix-septième siècle, Paris, Classiques Garnier, 2013.
Lavocat F., Arcadies malheureuses. Aux origines du roman moderne, Paris, Honoré Champion, 2000.
Lavocat F., Fait et fiction. Pour une frontière, Paris, Seuil, 2016.
McKitterick D., Print, Manuscript and the Search for Order, 1450-1830, Cambridge, CUP, 2005.
Melnikoff K., Elizabethan Book Publishing and the Makings of Literary Culture, Toronto, U of Toronto P, 2018.
Mentz S., Romance for Sale in Early Modern England : The Rise of Prose Fiction, Farnham, Ashgate, 2006.
Mounier P., « La situation théorique du roman en France et en Italie à la Renaissance », Seizième Siècle, 2008, n°4, p. 173-193.
Pavel T., « La mesure de la pastorale », Études Françaises, vol. 45, n°2, 2009, p. 13-24.
Plazenet L., « Inopportunité de la mélancolie pastorale : inachèvement, édition et
réception des œuvres contre logique romanesque », Études Épistémè, n° 3, 2003,
Pastorale et mélancolie (XVIe-XVIIesiècles), p. 28-96.
Prado P., « Sic transit… Un “roman” iconographique : Les Bergers d’Arcadiede Nicolas Poussin », L’Homme, n° 131, 1994, EHESS, p. 121-127.
Sherman W., Used Books : Marking Readers in Renaissance England, Philadelphie, U of Pennsylvania P, 2008.
Smith H. et Louise Wilson (dir.), Renaissance Paratexts, Cambridge, CUP, 2011.
Smyth A., Material Texts in Early Modern England, Cambridge, CUP, 2017.
Van Elslande J.-P., L’Imaginaire pastoral du dix-septième siècle, Paris, PUF, 1999.
Wall W., The Imprint of Gender : Authorship and Publication in the English Renaissance, Ithaca, Cornell UP, 1994.
Williams A., The Social Life of Books : Reading Together in the Eighteenth-Century Home,New Haven, Conn., Yale UP, 2017.
Salzman P., English Prose Fiction 1558-1700, Oxford, OUP, 1986[1985].
Scott Baumann E. et B. Burton, The Work of Form : Poetics and Materiality in Early Modern Culture, Oxford, OUP, 2014.



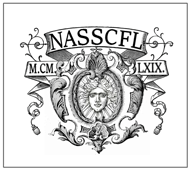
 L’empathie, notion centrale dans les humanités médicales aujourd’hui, n’a pas d’équivalent exact aux XVIeet XVIIe siècles. Des notions voisines, comme celles de pitié et de compassion, sont convoquées pour désigner les sentiments suscités par la douleur de l’autre. Dans une perspective interdisciplinaire, les articles de ce dossier s’intéressent aux réactions à la douleur physique dans des corpus variés : médecine pratique, élaborations théoriques ou écritures du for privé. Leur point commun est d’adopter une méthode d’investigation fondée sur l’analyse du lexique et des choix énonciatifs. L’« autre » est dans ce dossier un malade soigné par un médecin, un étranger observé par un voyageur, le représentant d’une altérité sociale ou d’une altérité naturelle comme les enfants ou les animaux. L’enquête met en évidence la manière dont les sujets s’émancipent des normes comportementales supposées être caractéristiques de la période. Elle contribue, au-delà, à déplacer les repères chronologiques dans l’histoire des sensibilités qui, pour la douleur, débute ordinairement au XVIIe siècle.
L’empathie, notion centrale dans les humanités médicales aujourd’hui, n’a pas d’équivalent exact aux XVIeet XVIIe siècles. Des notions voisines, comme celles de pitié et de compassion, sont convoquées pour désigner les sentiments suscités par la douleur de l’autre. Dans une perspective interdisciplinaire, les articles de ce dossier s’intéressent aux réactions à la douleur physique dans des corpus variés : médecine pratique, élaborations théoriques ou écritures du for privé. Leur point commun est d’adopter une méthode d’investigation fondée sur l’analyse du lexique et des choix énonciatifs. L’« autre » est dans ce dossier un malade soigné par un médecin, un étranger observé par un voyageur, le représentant d’une altérité sociale ou d’une altérité naturelle comme les enfants ou les animaux. L’enquête met en évidence la manière dont les sujets s’émancipent des normes comportementales supposées être caractéristiques de la période. Elle contribue, au-delà, à déplacer les repères chronologiques dans l’histoire des sensibilités qui, pour la douleur, débute ordinairement au XVIIe siècle.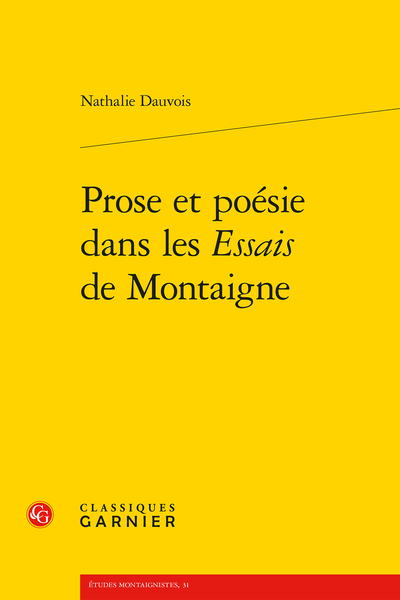 Nathalie Dauvois, Prose et poésie dans les Essais de Montaigne, Paris, Classiques Garnier, (1997) 2022.
Nathalie Dauvois, Prose et poésie dans les Essais de Montaigne, Paris, Classiques Garnier, (1997) 2022.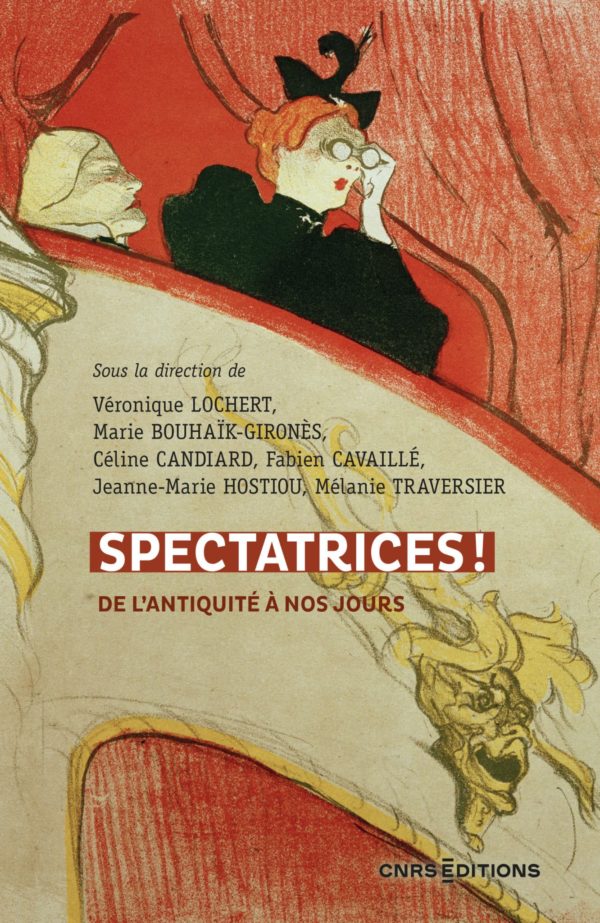 Spectatrices ! De l'Antiquité à nos jours, sous la direction de Véronique Lochert, Marie Bouhaïk-Gironès, Céline Candiard, Fabien Cavaillé, Jeanne-Marie Hostiou, Mélanie Traversier, Paris, CNRS Éditions, 2022.
Spectatrices ! De l'Antiquité à nos jours, sous la direction de Véronique Lochert, Marie Bouhaïk-Gironès, Céline Candiard, Fabien Cavaillé, Jeanne-Marie Hostiou, Mélanie Traversier, Paris, CNRS Éditions, 2022.