Volume 12, numéro 1, automne 2020
« LECTEUR | CENSEUR – PRESSE ET CORRESPONDANCE EN EUROPE (XVIE-XVIIIE SIÈCLE) »
Sous la direction de Sara Harvey (U. de Victoria) et Judith Sribnai (U. de Montréal)
(English below)
Nous proposons, dans le cadre de ce dossier, de lire conjointement deux formes essentielles dans les
pratiques d’écriture de l’Europe d’Ancien Régime : la correspondance et la presse. Ces deux corpus,
rarement rapprochés par la critique, présentent pourtant, outre leur imposant volume, de nombreux
points communs : fonctionnement sériel, rôle central qu’y tient l’actualité, pratique du commentaire,
fort ancrage dans une interaction avec le lecteur. Par exemple, lorsque la presse commence de prendre
forme en France au XVIIe siècle, c’est bien dans le genre épistolaire, plus ancien et codifié, qu’elle puise
à la fois un modèle et une légitimité. Ainsi, le fondateur du premier périodique culturel, Donneau de
Visé, ouvre la première livraison du Mercure galant par une lettre à une marquise en Province :
MADAME
Il n’estoit pas besoin de me faire souvenir que lors que vous partîtes de Paris, je vous promis
de vous mander souvent des nouvelles capables de nourrir la curiosité des plus Illustres de la
Province qui doit avoir le bonheur de vous posseder si long-temps. […] Passons donc aux
nouvelles, ou plustost à l’ordre que j’ay résolu pour vous en apprendre. Je vous écriray tous les
huit jours une fois, & vous feray un long & curieux détail de tout ce que j’auray appris pendant
la Semaine. (Mercure galant, 1672)
Cette amorce, exemplaire du lien tout particulier qui unit presse et correspondance, soulève plusieurs
questions : quelles inspirations (formelles, thématiques, énonciatives) la presse a-t-elle puisées dans les
correspondances? Comment les échanges épistoliers de la République des Lettres se sont-ils ajustés à
l’arrivée de cette nouvelle pratique en charge, désormais, des nouvelles fraîches? Y ont-ils puisé à leur
tour des modes et des manières? S’en sont-ils démarqués? Presse et correspondance ont-elles été
perçues comme des formes concurrentes ou, au contraire, complémentaires? Observe-t-on des
spécificités nationales, régionales, linguistiques? Il s’agit ainsi d’éclairer les particularités propres à ces
deux pratiques d’écriture qui sont également des pratiques de sociabilité mondaine et intellectuelle.
Cette approche, en mettant en relief leur évolution du point de vue éditorial, s’inscrit notamment dans
une histoire des médias sur la longue durée.
Pour aborder ces questions, nous proposons de partir de la figure du lecteur, lecteur à la fois juge et
censeur, qui constitue le centre du dispositif énonciatif de ces écritures du temps présent (Volpilhac;
Harvey). Cette figure participe en effet activement à définir un art de la communication et un savoirfaire
discursif essentiels à toutes formes de médiation. Être réel dont on sollicite regard, réponse ou
jugement, ou figure construite et idéalisée, il joue un rôle déterminant dans les choix discursifs et
éthiques des auteurs – d’ailleurs eux-mêmes lecteurs. C’est autour de lui notamment que se constitue
l’effet sériel, car c’est lui qu’il faut fidéliser et c’est avec lui que se tisse une relation sur la longue durée.
Il témoigne également du fait que la presse comme la correspondance reposent sur une relation de
dépendance explicite et le plus souvent explicitée avec la critique.
Afin de saisir les effets d’imitation, d’emprunt, de transformation, de survivance ou de métamorphose
de ce lecteur-censeur d’une pratique à l’autre, nous partirons du XVIe siècle, c’est-à-dire d’une période
qui précède les débuts de la presse, mais qui connaît toutefois les « occasionnels », les « canards » et
les nouvelles à la main. Cette perspective en amont permet de distinguer les traits de ce lecteur dont
la presse pourra s’inspirer par la suite. Nous nous arrêterons au début du XIXe siècle, début de « l’ère
médiatique » (Thérenty et Vaillant) qui recouvre d’autres enjeux. Le parcours d’une telle période
permettra de saisir l’élaboration de la figure d’un lecteur-censeur et, à travers elle, quelques aspects
essentiels de la relation qui existe entre presse et épistolaire et histoire des médias anciens en Europe.
Les articles réunis porteront soit sur des correspondances, soit sur la presse, soit sur les deux, et le
corpus choisi peut s’attacher à un pays européen ou encore à la comparaison entre deux ou plusieurs
pays. De ces rapprochements, nous tenterons de dégager : 1) quelques traits de ce lecteur-censeur et
de son évolution au cours des siècles (ami, mauvaise langue, savant, amateur, professionnel en
herbe); 2) les effets de parenté, de distance, d’écho ou de reprise entre écriture épistolaire et écriture
périodique (l’importance en particulier d’un dialogue dans le temps, de l’établissement de critères de
lecture et de jugement communs, ainsi que de la tension entre écriture coopérative et singulière).
On pourra s’interroger notamment (mais non exclusivement) sur :
- Le lecteur et les procédés de légitimation de l’écriture épistolaire ou périodique;
- Les portraits de lecteur et leur lien avec la critique;
- La place de la réception dans la production écrite : éléments d’anticipation et d’intérêts, de
réponses heureuses ou contrariées, de critiques constructives ou dévastatrices;
- Les évocations, explicites ou non, de la censure et de la loi;
- Les liens ou les antagonismes entre lecteur critique et mondain;
- Les transformations de la figure du lecteur en fonction des changements de support de
publication (correspondances paraissant en volume; extraits d’échanges épistoliers publiés
dans la presse; choix de correspondances autour d’un destinataire du type Lettres à…; etc.).
Les propositions d’article en français ou en anglais, comprenant un résumé d’environ 250 mots ainsi
qu’une courte notice biographique, devront parvenir par courriel d’ici le 15 novembre 2019 à
saraharvey@uvic.ca et judith.sribnai@umontreal.ca. Après évaluation par le comité de rédaction, une
réponse sera donnée en décembre. Les textes complets des articles dont la proposition aura été
acceptée devront être envoyés au plus tard le 1er mai 2020. Ils seront soumis, à l’aveugle, à l’évaluation
par les pairs. Le numéro paraîtra à l’automne 2020.
Bibliographie indicative
Beaurepaire, Pierre-Yves, Häseler, Jens et McKenna, Anthony (dir.), Les réseaux de correspondance à l’âge
classique (XVIe-XVIIIe siècle), Saint-Etienne, Presses de l’Université de Saint-Etienne, 2006.
Brétéché, Marion, Les Compagnons de Mercure. Journalisme et politique dans l’Europe de Louis XIV,
Ceyzérieux, Champ Vallon, 2015.
Cave, Christophe (dir), Le règne de la critique. L’Imaginaire culturel des Mémoires secrets, Paris, H. Champion,
2010.
Diaz, Brigitte (dir.), L’épistolaire au féminin : correspondance de femmes (XVIIIe-XXe siècle), Paris, PUF, 2017.
Dumouchel, Susanne, Le journal littéraire en France au dix-huitième siècle. Émergence d’une culture virtuelle,
Oxford, Voltaire Fondation, 2016.
Feyel, Gilles, La presse en France des origines à 1944, Paris, Ellipses, 2007.
Gevrey, Françoise et Lévrier, Alexis (dir.), Érudition et polémique dans les périodiques anciens, XVIIe-XVIIIe
siècle, Reims, Presses universitaires de Reims, 2009.
Haffemayer, Stéphane, L’information dans la France du XVIIe siècle : La Gazette de Renaudot, de 1647 à
1663, Paris, H. Champion, 2002.
Harvey, Sara (dir.) La critique au présent. Émergence du commentaire sur les arts (16e-18e siècles), Paris,
H. Champion, 2019.
Lévrier, Alexis, Les journaux de Marivaux et le monde des spectateurs, Paris, Presses universitaires Paris-
Sorbonne, 2007.
Panzera, Maria Cristina (dir.), L’exemplarité épistolaire. Du Moyen-Âge à la première modernité, Bordeaux,
Presses universitaires de Bordeaux, 2013.
Thérenty, Marie-Ève et Vaillant, Alain, 1836 : l’an 1 de l’ère médiatique. Étude littéraire et historique du journal
La Presse d’Émile de Girardin, Paris, Nouveaux mondes Éditions, 2001.
Volpihac, Aude, Le secret de bien lire. Lecture et herméneutique de soi en France au XVIIe siècle, Paris,
H. Champion, 2015.
Enfin, mentionnons l’indispensable répertoire des éditions numérisées, le gazetier universel
(http://gazetier-universel.gazettes18e.fr/), l’édition numérique d’Anne Piéjus sur le Mercure
galant (http://obvil.sorbonne-universite.site/corpus/mercure-galant/), celui de Stéphane
Haffemayer sur la Gazette de Renaudot (http://www.unicaen.fr/gazette/presentation.php
Call for Papers
Volume 12, Number 1, Fall 2020
“READER | CENSOR – THE PRESS AND CORRESPONDENCE IN EUROPE (16TH – 18TH CENTURY)”
Edited by Sarah Harvey (U. of Victoria) and Judith Sribnai (U. de Montréal)
Within the framework of this issue, we propose a joint reading of two forms fundamental to the
writing practices of Ancien Régime Europe: correspondence and the press. The two corpuses,
although rarely examined together by critics, have nevertheless numerous characteristics in common
in addition to their imposing volume: their seriality, the central role played by the news, their
commentary practices, their solid foundations in interactions with readers. For example, when the
press began to take shape in France in the 17th century, it was from the epistolary genre, older and
codified, that it drew a model and a legitimacy. Thus, Donneau de Visé, the founder of the first cultural
periodical, began the inaugural issue of the Mercure galant with a letter addressed to a marquise in
Provence:
MADAME
It is not necessary for me to remind you that when you left Paris, I promised to convey to you
often news capable of nourishing the curiosity of the most distinguished of the Province who
must have the happiness of having you for such a long time […] Let us move on, therefore, to
the news, or rather to the order that I have made of it for you to learn about it. I will write you
once every eight days & will make a long and inquiring account of everything that I will have
heard during the week. (Mercure galant, 1672)
De Visé’s preamble illustrates the unique tie that binds the press and correspondence while raising
several questions: what inspirations (formal, thematic, enunciative) did the press draw from letters?
How did epistolary exchanges in the Republic of Letters adjust to the arrival of this new practice that
took charge, from then on, of fresh news? Did they, in turn, incorporate customs and manners? Did
they differentiate themselves? Were the press and correspondence perceived as competing forms or,
on the contrary, complementary forms? Does one perceive national, regional, or linguistic specificities?
Hence, it is about bringing to light the particularities of each of these two writing practices which are
also practices of sophisticated and intellectual sociability. This approach, by highlighting their
evolution from a publishing point of view, fits into, among others, a long-term history of the media.
To address these questions, we propose starting with the reader figure, the reader who is both judge
and censor, who is at the heart of the enunciative device of these accounts of the current time
(Volpilhac; Harvey). Indeed, this figure participates actively in defining a communication art and a
discursive know-how both of which are essential to all forms of mediation. Whether they be real
people, whose notice, response or judgment is solicited, or constructed and idealised figures, readers
play a determining role in the discursive and moral choices of authors – who, moreover, are themselves
readers. It is notably around them that the serial effect takes place and it is with them that a relationship
is woven over time. They also testify to the fact that both the press and letters rely on an explicit
dependency relationship that is most often expressed through criticism.
In order to understand the effects of imitation, borrowing, transformation, survival or metamorphosis
of this reader-censor from one practice to another, we will start from the 16th century, that is to say,
from a period that precedes the beginnings of the press, but which was already familiar with
“occasional sheets,” “rags,” and hand-written news. This ascending perspective makes it possible to
identify reader characteristics from which the press could then draw inspiration. We will end at the
early 19th century, on the threshold of the “media era” (Thérenty et Vaillant) which encompasses other
stakes. The journey through such a period permits an understanding of the development of the readercensor
figure and, through that figure, some of the key aspects of the relationship that exists between
the press and correspondence and the history of old media in Europe.
Collected papers will focus either on correspondence or the press or both, and the selected corpus
can be associated with a European country or with a comparison between two or among several
countries. By bringing these corpuses together, we seek to reveal 1) a few traits of these reader-censors
and of their evolution over the course of the centuries (friend, spiteful gossiper, scholar, amateur,
budding professional;) 2) the effects of kinship, of distance, of echoing or of re-using between letterwriting
and periodical writing (the importance in particular of a dialogue at that time, of the
establishment of reading criteria and of common judgement as well as the tension between cooperative
and individual writing).
Possible topics to be examined include (but are not limited to):
- The reader and the legitimization processes of correspondence or of periodical writing;
- Reader portraits and their connection to criticism;
- The place of reception in written production: notions of anticipation and of interests, of happy
or frustrated responses, of constructive or devastating criticism;
- Evocations, explicit or not, of censorship and of the law;
- The links or the antagonisms between critical and urbane readers
- Transformations of reader figures according to changes in publication media (correspondence
collections; extracts of epistolary exchanges published in the press; choice of letters around an
addressee, such as Letters to; etc.).
Submissions for papers in French or in English consisting of an abstract of approximately 250 words
as well as a short biographical notice should be emailed to saraharvey@uvic.ca and
judith.sribnai@umontreal.ca by November 15, 2019. Proposals will be evaluated by the editorial
committee and authors will be informed of the committee’s decision in December. The complete text
of papers whose proposals were accepted should be submitted by May 1, 2020 at the latest. They will
then undergo a blind peer review. Publication is scheduled for autumn 2020.
See the selected bibliography above.



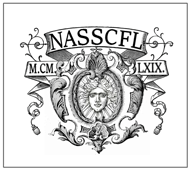
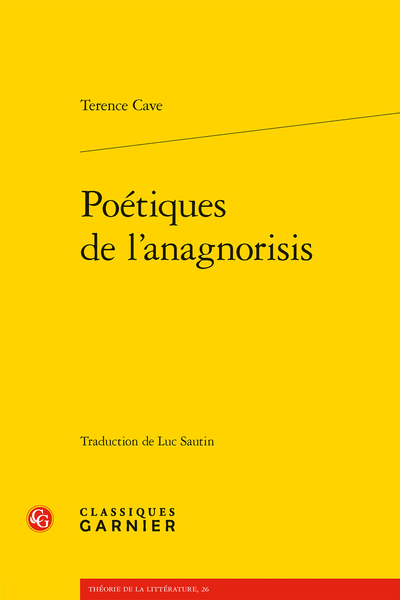 Terence Cave, Poétiques de l’anagnorisis, trad. Luc Sautin, Paris, Classiques Garnier, Coll. Théorie de la littérature, septembre 2022, 528 p.
Terence Cave, Poétiques de l’anagnorisis, trad. Luc Sautin, Paris, Classiques Garnier, Coll. Théorie de la littérature, septembre 2022, 528 p.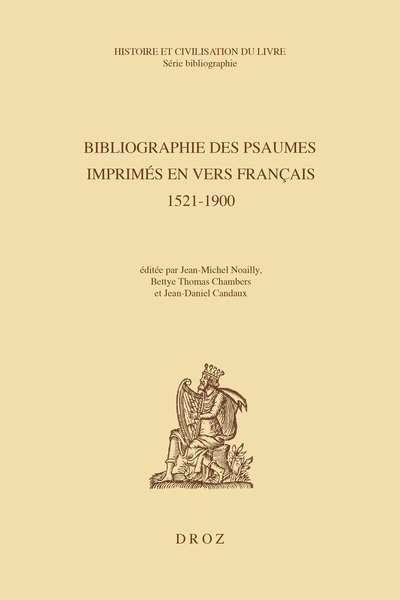 Bibliographie des Psaumes imprimés en vers français. 1521-1900 (en quatre tomes), édité par Jean-Michel NOAILLY, Jean-Daniel CANDAUX, Bettye Thomas CHAMBERS, Genève, Droz, 2022.
Bibliographie des Psaumes imprimés en vers français. 1521-1900 (en quatre tomes), édité par Jean-Michel NOAILLY, Jean-Daniel CANDAUX, Bettye Thomas CHAMBERS, Genève, Droz, 2022.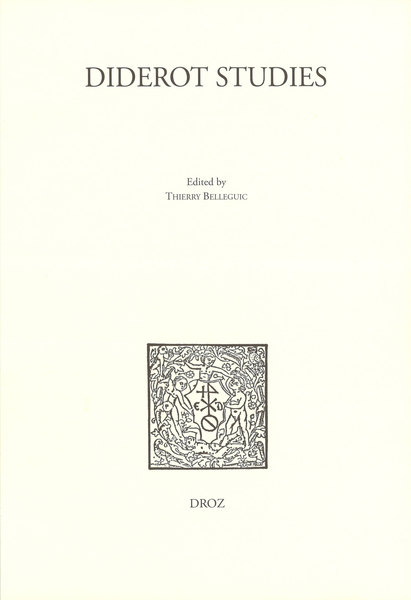 Diderot studies, tome 37. "Diderot et l'identité, dans le jeu contradictoire des possibles"
Diderot studies, tome 37. "Diderot et l'identité, dans le jeu contradictoire des possibles"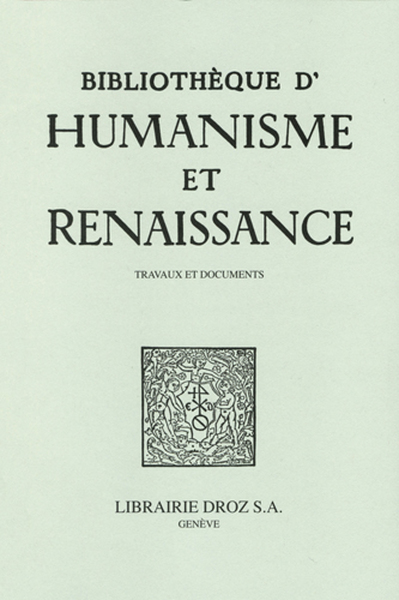 Bibliothèque d'Humanisme et Renaissance, LXXXIV-I (2022-1)
Bibliothèque d'Humanisme et Renaissance, LXXXIV-I (2022-1)