20-21 mars 2020
Université Paris Est Créteil
Laboratoire IMAGER EA 3958
(L'anglais suit)
Sous l’intitulé « Frontières de l’image », nous proposons d’ouvrir un nouvel espace de réflexion et de discussion sur les enjeux de l’image envisagée dans la pluralité de ses acceptions, pour faire suite à la série de séminaires qui ont eu lieu à Créteil entre 2017 et 2019 et à la journée d’étude du 23 Novembre 2018 : « Pouvoirs de l’image : Affects et Émotions ».
L’omniprésence des images pose au chercheur la question de leur conceptualisation : on constate que le terme recouvre une diversité d’objets menant à des définitions instables et des questionnements mouvants. C’est ce dynamisme conceptuel que nous avons voulu placer au cœur de notre réflexion.
En établissant des distinctions entre visuel, graphique, perceptif, mental et verbal, W.J.T Mitchell (1984) montre que les images ont souvent été étudiées et diversement définies selon les champs disciplinaires qui pouvaient s’y intéresser (histoire de l’art, philosophie, psychologie, littérature, etc.) mais il nous invite aussi à repenser ces définitions pour croiser différentes approches et ainsi, modifier les relations que nous entretenons avec elles. Comment pourrait-on définir une image qui irait « au-delà des frontières du visuel » ainsi que le préconise Mitchell ?
Une image se définit-elle par ses frontières ? La définition d’une image varie-t-elle en fonction de son médium ? (photographie, cinéma, peinture, dessin, texte….) Comment les frontières de l’image visuelle sont-elles interrogées par d’autres pratiques artistiques ? (musique, danse, théâtre, performance…) Dans la mesure où les nouvelles technologies peuvent se substituer aux savoir-faire des artistes dans le traitement des matériaux –production d’effets de vraisemblance, altération des impressions visuelles captées sur un support, par exemple–, nous proposons de poursuivre le travail de redéfinition de l’art et de ses frontières, auquel nous incite cette malléabilité des images. La relation entre réel et virtuel avec les nouvelles technologies induit-elle une modification anthropologique de notre perception ?
On pourra s’intéresser plus particulièrement aux trois axes suivants :
Axe 1 : poétique de l’image ; rapport entre langue et image
On s’intéressera au processus créatif de l’image poétique pour interroger notamment le rapport d’antériorité entre objet et image. A l’instar de Persée, le poète doit passer par l’indirection, le mythe, la fiction (compris dans son étymologie de fingere), la création d’images, pour tenter de ramener le monde dans le langage. L’existence même de l’image serait toujours déjà prise dans une indirection qui la postule dans un après-coup illusoire :« l’image, d’après l’analyse commune, est après l’objet : elle en est la suite ; nous voyons, puis nous imaginons. Après l’objet viendrait l’image. ‘Après’ signifie qu’il faut d’abord que la chose s’éloigne pour se laisser ressaisir. [. . .] L’éloignement est ici au cœur de la chose » (Blanchot, 1955, p. 343). Cet éloignement intrinsèque à l’image rendrait donc son rapport à la « chose » indéterminé, indéfini : « le bonheur de l’image, c’est qu’elle est une limite auprès de l’indéfini » (Ibid., pp. 341-42). Les frontières entre l’image et le réel seraient-elle donc à considérer en termes spatiaux et temporels ?
La frontière ténue entre image et objet, s’il en est une, croise également la frontière entre texte et image : comme les travaux d’Anne-Marie Christin sur l’écriture ont pu le démontrer (2009), le texte peut parfois être considéré comme image avant d’être lu comme tel. Depuis l’existence de l’imprimerie, écrivains et poètes n’ont eu de cesse d’explorer la matérialité de l’écriture en jouant avec différents types de supports, encres, typographies… les romans visuels hérités d’œuvres comme Tristram Shandy de Lawrence Sterne pourraient avoir une place de choix dans le colloque, et particulièrement en ce qu’ils peuvent interroger la part d’implicite de la langue en regard des images qui se donnent ouvertement à lire et/ou à voir.
L’image poétique, telle que la travaille la langue, pourra aussi être une piste de travail à travers une réflexion sur la métaphore et la métonymie, en référence aux travaux de Jakobson ou à ceux de Guy Rosolato par exemple, pour qui l’oscillation entre ces deux pôles est en elle-même source de jubilation esthétique. Ainsi, un texte peut-il, sans être d’emblée perçu comme imagé, s’infléchir vers une interprétation métaphorique ou “faire image” ?
Axe 2 : Image et politique
La question des frontières de l’image évoque prosaïquement le cadrage –champ, hors-champ– et le point de vue –quel angle, et quel angle-mort ? En cela, l’auteur de l’image est celui qui a le pouvoir d’inclure et d’exclure de la représentation, de communiquer par l’image son point de vue sur le sujet représenté. Interroger les frontières de l’image, c’est donc aussi poser la question de l’autorité et de la légitimité des points de vue. Dès lors, déplacer les frontières entre auteur et sujet des représentations a conduit à inventer de nouvelles pratiques de l’image dont la diversité et l’impact restent encore peu étudiées. Différents groupes sociaux, des femmes aux minorités ethniques et LGBTQ, ont ainsi exploré leur sentiment d’appartenance et de communauté par l’image sous toutes ses formes. En répondant aux stéréotypes et aux représentations dominantes, leurs images n’en ont-elles pas révélé les frontières invisibles ? Plus largement, on pourra explorer le rôle des images dans la création de normes ou comment, par le miroir des images et les processus d’identification, les frontières des images se traduisent parfois en hiérarchies, modèles ou frontières sociales.
S’agissant de violence politique, on pourra aussi s’interroger sur les limites du tolérable dans une image : qu’est-ce qui la rend intolérable ? Est-ce sa capacité à offrir la réalité de l’horreur à la jouissance des voyeurs ? Est-ce, au contraire, son incapacité à rendre compte de la totalité de l’horreur ? Dans ce cadre, on pourra s’interroger sur les dispositifs de visibilité qui bousculent les logiques de la banalisation et ravivent notre attention envers les corps souffrants.
Axe 3 : Transformation anthropologique. Sommes-nous à une nouvelle ère de l’image, de la perception ?
À l’ère de la reproduction mécanique des images (Benjamin) et de leur circulation accélérée sous format numérique par internet et les réseaux sociaux, les frontières de l’image semblent n’avoir jamais été aussi mouvantes. Appropriations, détournements et memes se jouent à loisir des définitions traditionnelles de l’image (Gunthert). Ainsi les nouvelles frontières des images sont-elles désormais à rechercher dans les usages qui en sont faits et dans les contextes qui leur donnent sens ? Ou encore, la fluidité extrême de l’image numérique ne doit-elle pas nous amener à repenser entièrement notre définition même de l’image et de ses frontières, au-delà de sa matérialité, pour s’intéresser davantage à la phénoménologie de la perception (Hansen), à la réponse corporelle, aux affects et émotions qu’elle suscite ?
Ce colloque rassemblera des chercheurs de différentes spécialités appartenant aux aires culturelles anglophones, hispanophones, italophones et germanophones reflétant ainsi la pluralité des spécialités de recherche représentées au Laboratoire IMAGER. Les communications pourront porter sur différentes périodes de la Renaissance à la période contemporaine.
Date limite d’envoi des propositions : 15 septembre 2019
Réponse aux participants : 15 octobre 2019
Les propositions, d’une longueur de 500 mots environ, assorties d’une courte bio-bibliographie, sont à envoyer à marie.olivier@u-pec.fr et claire.fabre-clark@u-pec.fr
Comité d’organisation :
Karine Chambefort-Kay, Claire Fabre, Ivan Jimenez, Marie Olivier, Stéphane Resche (laboratoire IMAGER).
Comité scientifique :
Perle Abbrugiati, Aix-Marseille Université.
Jérôme Bazin, Université Paris-Est Créteil.
Mathilde Bertrand, Université Bordeaux Montaigne.
Géraldine Chouard, Université Paris-Dauphine.
Corinne Cristini, Sorbonne Université.
Pitsie Feenstra, Université Montpellier 3.
Isabelle Gadoin, Université de Poitiers.
Giovanni Joppolo, École nationale supérieure d'art-Villa Arson de Nice.
Emmanuel Vincenot, Université Paris-Est Marne-la-Vallée.
Karine Winkelvoss, Université de Rouen.
‘The Frontiers of the image’
International Conference
20-21 March 2020
Université Paris-Est Créteil
IMAGER EA 3958
With the title « The frontiers of the image » we would like to open up a new space for discussion and reflection on the notion of “image” in the plurality of its acceptations, following a series of seminars which took place in Créteil between 2017 and 2019, and more specifically after our conference of November 23, 2018 entitled “Pouvoirs de l’image: affects et émotions” (“The Power of the Image: Affects and Emotions”.)
The omnipresence of images raises the question of their conceptualization: the term encompasses a great diversity of objects which have given rise to unstable definitions and queries. It is this conceptual dynamism that we wish to place at the heart of our conference
By establishing distinctions between the visual, the graphic, the perceptual and the verbal aspects of images, W.J.T Mitchell (1984) has shown that: the definitions of images vary according to the disciplines and perspectives from which they are studied (art history, philosophy, psychology, literature etc.) but his essay also invites us to reconsider the definitions of images and how, by combining the different approaches they may modify our relationship with them. As Mitchell asks, is it possible to define an image which would go (goes) “beyond the frontiers of the visual”?
Is an image defined by its frontiers? Does the definition of an image vary depending on its medium? (photography, film, painting, drawing, text, etc.) How are the frontiers of the visual image redefined by other artistic practices (music, dance, theater, performance…)? Insofar as new technologies may supplement artistic skills in the production of a work –by creating new effects of verisimilitude, or altering the visual impressions captured by a medium –we wish to pursue the redefinition of art and its frontiers prompted by the malleability of images. Does the new relationship between the virtual and the real entail an anthropological transformation of our perception?
The following three themes will be considered:
Theme 1: The poetics of the image: the relationship between language and image
It will be possible to envisage the creative process of the poetic image and the question of anteriority between object and image. Like Perseus, the poet follows an indirect route which involves myth, fiction (to be understood in its etymological sense of fingere) and the creation of images whenever he wants to transcribe the world into language. The very existence of the image is thus always part of an indirect movement which artificially posits it secondary to the object, as Blanchot states: “The image, according to the ordinary analysis, is secondary to the object. It is what follows. We see, then we imagine. After the object comes the image. "After" means that the thing must first take itself off away in order to be grasped. But this remove is not the simple displacement of a moveable object which would nevertheless remain the same. Here the distance is in the heart of the thing.” (Blanchot, 1982, p. 254). It seems as though this intrinsic distance of the image renders its relation to the object indeterminate and indefinable: “The gratifying aspect of the image is that it constitutes a limit at the edge of the indefinite.” (Ibid. p. 253) Should we then consider the frontier between the real and the image in spatial and temporal terms?
The tenuous frontier between image and object intersects with the frontier between image and text. As Anne-Marie Christin has demonstrated in her work on writing (2009), a text can sometimes be considered as a visual image before being read as a text. Ever since printing has existed, writers and poets have never ceased to explore the materiality of writing by playing with different types of materials, ink, typography etc. The visual novels directly inherited from works like Tristram Shandy by Lawrence Sterne, could occupy an important place in this conference particularly in the way that they expose the implicitness of language and the apparent explicitness of images.
The poetic image could also offer another line of study through a reflection on metaphor and metonymy, in reference to Roman Jakobson’s or Guy Rosolato’s works (for example), for whom the oscillation between those two poles is a source of aesthetic jubilation. Thus can a text, which at first sight seems devoid of literary “images” move towards a metaphorical interpretation, or become an image in itself?
Theme 2: Political frontiers
Examining the frontiers of images inevitably raises the question of framing –what is on screen or off screen– and that of viewpoint – what is the visual angle and what are the blind spots? In this regard, the author of an image has the power to include or exclude from representation, as he or she conveys his or her own point of view on the subject. Therefore, the question of frontiers, concerning images, is bound up with notions of authorship and the legitimacy of viewpoints. In many instances, addressing the frontiers between the author and the subject of images has meant inventing new visual practices, the diversity and impact of which still require further study. Many social groups, including women, ethnic minorities and LGBTQ communities, for example, have explored their sense of belonging and community by producing images of all kinds. If such images offer a response to stereotypes and dominant representations, how do they reveal the latter’s invisible frontiers? More generally, one could examine the role played by images in the creation of norms, or in other words, how the frontiers of images sometimes produce social standards, hierarchies and borders.
As concerns political violence, the question may also be raised as to what can be tolerated in an image: what are the limits of the (un)bearable? What takes a picture beyond bearable? Is it the way it offers the reality of horror for its viewers to relish? Or conversely, is it a picture’s inability to render the full horror of a scene? Within this prospect, it will be useful to consider how devices entailing more visibility may paradoxically upset the mechanisms of compassion fatigue and stir the viewers’ attention towards suffering bodies.
Theme 3: Anthropological transformation: is this a new era for images and perception?
In the age of the mechanical reproduction of images (Benjamin) and of their instant circulation as digital objects via the internet and social media, the frontiers of pictures have never seemed so labile. Appropriations, imitations and memes have consistently challenged the traditional frontiers of images (Gunthert). Is it the case then, that the new frontiers of images should now be defined by the uses that are made of them and by the contexts that frame their meaning? The extreme fluidity of digital images today may require us to entirely rethink our definition of images and their frontiers, by shifting beyond their material condition and taking a greater interest in the phenomenology of perception (Hansen), in the body’s response to them, or in the affects and emotions that they elicit.
This conference will bring together scholars from the English-, Spanish-, Italian- and German-speaking cultural fields of research, thus reflecting the diversity of research within the group IMAGER. Papers addressing all periods of time from the Renaissance to the contemporary period are welcome.
Please send your proposals to marie.olivier@u-pec.fr and claire.fabre-clark@u-pec.fr by 15 September 2019 with an abstract of about 500 words and a brief biographical notice.
Feedback will be sent by 15 October 2019
Organizing committee:
Karine Chambefort-Kay, Claire Fabre, Ivan Jimenez, Marie Olivier, Stéphane Resche (laboratoire IMAGER).
Scientific committee:
Perle Abbrugiati, Aix-Marseille Université.
Jérôme Bazin, Université Paris-Est Créteil.
Mathilde Bertrand, Université Bordeaux Montaigne.
Géraldine Chouard, Université Paris-Dauphine.
Corinne Cristini, Sorbonne Université.
Pitsie Feenstra, Université Montpellier 3.
Isabelle Gadoin, Université de Poitiers.
Giovanni Joppolo, École nationale supérieure d'art-Villa Arson de Nice.
Emmanuel Vincenot, Université Paris-Est Marne-la-Vallée.
Karine Winkelvoss, Université de Rouen.
References
Alloa, Emmanuel, ed. Penser l’image. Dijon : Presses du réel, 2010.
---, ed. Penser l’image II. Anthropologies du visuel. Dijon : Presses du réel, 2015.
---, ed. Penser l’image III. Comment lire les images ? Dijon : Presses du réel, 2017.
Barthes, Roland. La Chambre claire. Paris : Éditions de l’Étoile, Gallimard, Le Seuil, 1980.
L’obvie et l’obtus. 1964. Essais critiques III. Paris : Seuil, 1982.
Blanchot, Maurice. L’Espace littéraire. Paris : Gallimard, coll. folio essais, 1955.
---. The Space of Literature. Trans. Ann Smock. Lincoln: U of Nebraska P, 1982.
Didi-Huberman, Georges. Images malgré tout. Paris : Éditions de Minuit, 2003.
---. Quand les images prennent position. Paris : Éditions de Minuit, 2009.
---. Peuples exposés, peuples figurants, tome 4 de L’Œil de l’histoire. Paris : Éditions de Minuit, 2013.
---. Peuples en larmes, peuples en armes, tome 6 de L’Œil de l’histoire. Paris : Éditions de Minuit, 2016.
Calvino, Italo. Leçons américaines, Six propositions pour le prochain millénaire. 2002. Trad. Christophe Mileschi. Paris : Gallimard, 2017.
Calvino, Italo. Nos ancêtres. Trad. Martin Rueff. Paris : Gallimard, 2018.
---. « Comment j’ai écrit un de mes livres ». Actes sémiotiques VI. 51 (1984) : 1-23.
Christin, Anne-Marie. La Déraison graphique. Paris : Flammarion, 2009.
Gunthert, André. L’image partagée, La photographie numérique. Paris : Textuel, 2015.
Benjamin, Walter. L’Œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique (1939). Trad. Frédéric Joly. Paris : Payot, 2013.
Hansen, Mark B. H. New Philosophy for New Media. Cambridge: MIT Press, 2004.
Jakobson, Roman. Essais de linguistique générale. Paris : Minuit, 1963.
Mulvey, Laura. “Visual Pleasure and Narrative Cinema.” Film Theory and Criticism: Introductory Readings. Eds. Leo Braudy and Marshall Cohen. New York: Oxford UP, 1999. 833-44.
Mitchell, W. J. T. “What Is an Image?” New Literary History 15.3, Image/Imago/Imagination (Spring, 1984): 503-537.
---. Image Science: Iconology, Visual Culture, and Media Aesthetics. Chicago: University of Chicago Press, 2015.
Rancière, Jacques. Le Destin des images. Paris : La Fabrique, 2003.
Rancière, Jacques. Le Spectateur émancipé. Paris : La Fabrique, 2008.
Rosolato, Guy. « L’oscillation métaphoro-métonymique ». La Relation d’Inconnu. Paris : Gallimard, 1978.
http://imager.u-pec.fr/



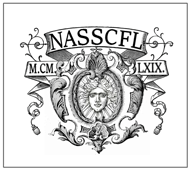
 Frédéric Cousinié, Paysage du paysage. Nicolas Poussin, Claude Gellée Le Lorrain, Sébastien Bourdon, Dijon, Presses du réel – Œuvres en société, 2022, 446 pages, 51 ill., 32 euros (isbn : 978-2-37896-232-6).
Frédéric Cousinié, Paysage du paysage. Nicolas Poussin, Claude Gellée Le Lorrain, Sébastien Bourdon, Dijon, Presses du réel – Œuvres en société, 2022, 446 pages, 51 ill., 32 euros (isbn : 978-2-37896-232-6).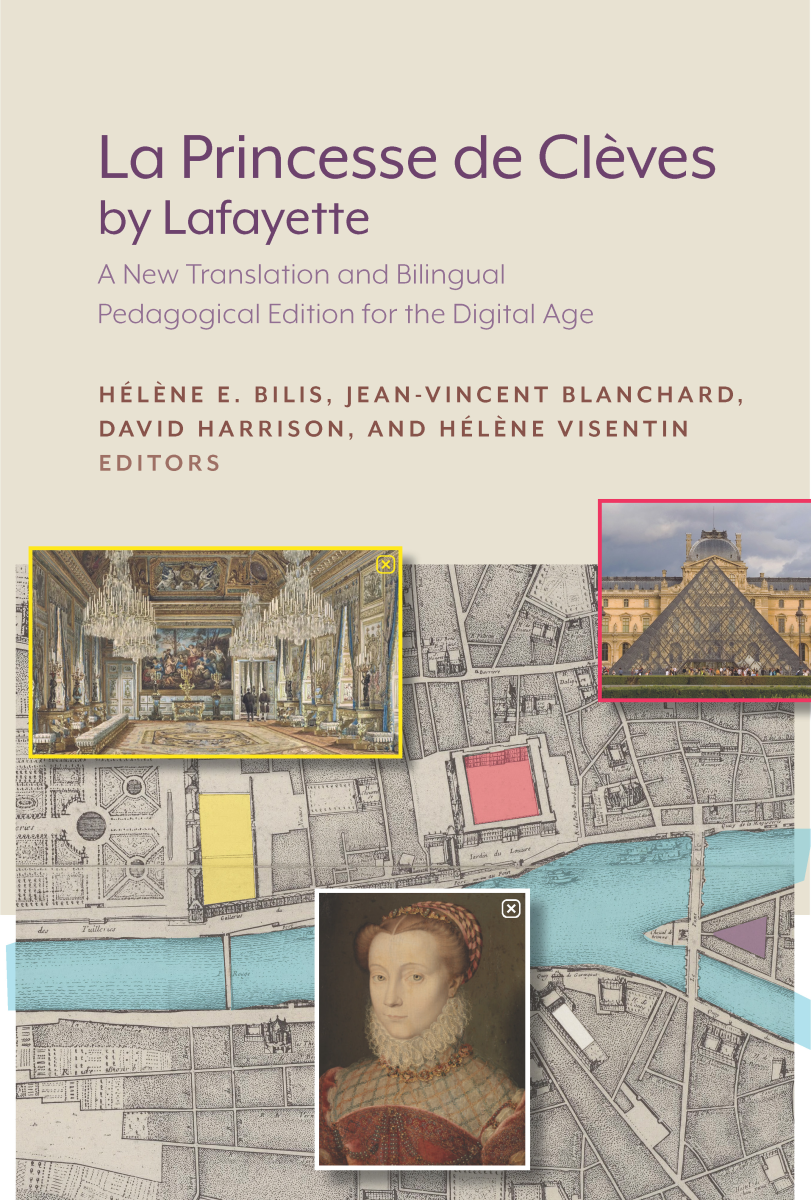 Hélène E. Bilis, Jean-Vincent Blanchard, David Harrison, and Hélène Visentin. La Princesse De Clèves by Lafayette: A New Translation and Bilingual Pedagogical Edition for the Digital Age. Ann Arbor, MI: Lever Press, 2022.
Hélène E. Bilis, Jean-Vincent Blanchard, David Harrison, and Hélène Visentin. La Princesse De Clèves by Lafayette: A New Translation and Bilingual Pedagogical Edition for the Digital Age. Ann Arbor, MI: Lever Press, 2022.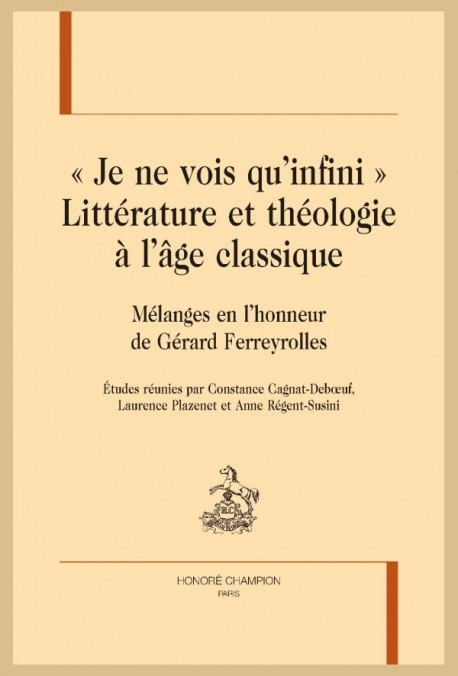 LITTÉRATURE ET THÉOLOGIE À L'ÂGE CLASSIQUE. "JE NE VOIS QU'INFINI". Mélanges en l'honneur de Gérard Ferreyrolles, dir. Constance Cagnat-Deboeuf, Laurence Plazenet et Anne Régent-Susini, Paris, Honoré Champion, 2022.
LITTÉRATURE ET THÉOLOGIE À L'ÂGE CLASSIQUE. "JE NE VOIS QU'INFINI". Mélanges en l'honneur de Gérard Ferreyrolles, dir. Constance Cagnat-Deboeuf, Laurence Plazenet et Anne Régent-Susini, Paris, Honoré Champion, 2022.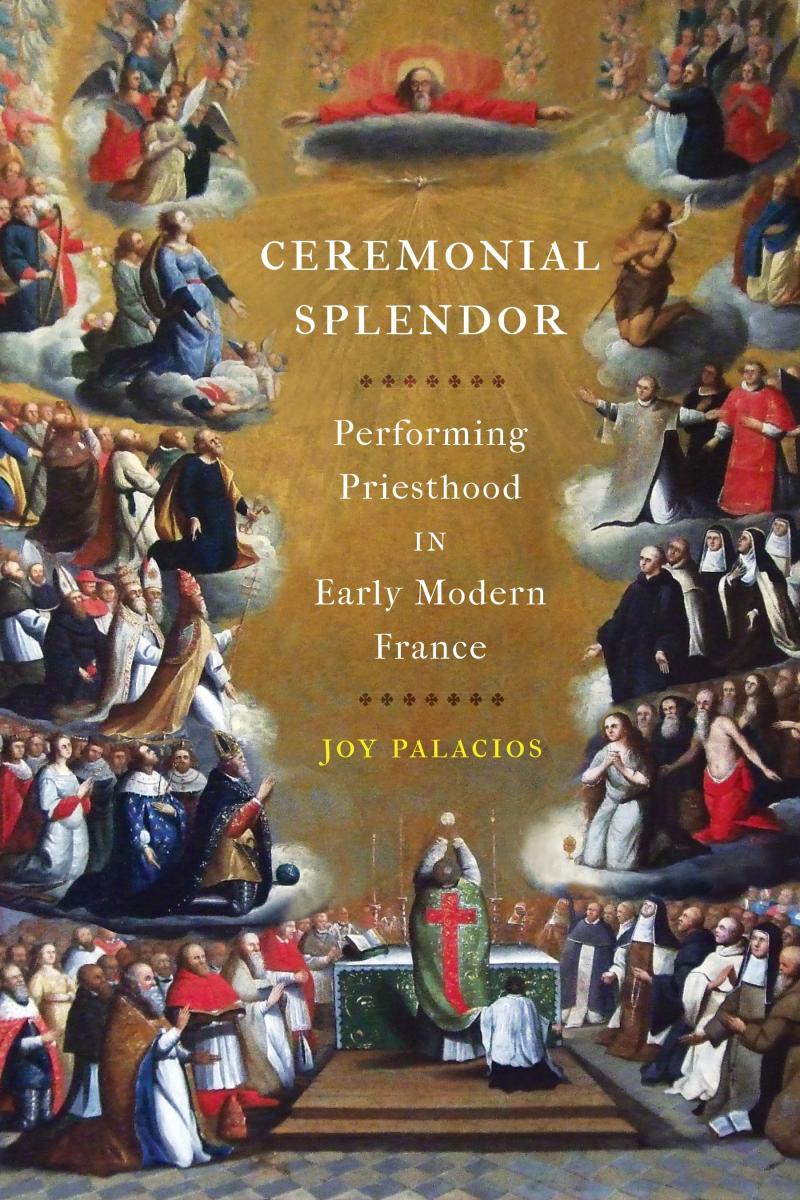 Joy Palacios, Request Desk/Exam Copy Download Cover Image Ceremonial Splendor Performing Priesthood in Early Modern France, University of Pennsilvania Press, 2022.
Joy Palacios, Request Desk/Exam Copy Download Cover Image Ceremonial Splendor Performing Priesthood in Early Modern France, University of Pennsilvania Press, 2022. En octobre 1685, Quinault est au faîte de sa carrière. Le Temple de la Paix, qui comptera parmi ses danseurs tout ce qu’il y a de plus brillant à la cour, est souvent considéré comme le dernier d’une longue lignée de ballets de cour. C’est une œuvre complexe et audacieuse, qui met en relief les différences entre la génération de Louis XIV et celle du Dauphin, commanditaire de l’œuvre. Créée trois jours après la révocation de l’Édit de Nantes, cette pastorale évoque les joies de la paix et du repos, les plaisirs et les peines de l’amour, le héros glorieux qui assure le bonheur des autres. Sa structure inhabituelle suggère, cependant, de nombreuses tensions.
En octobre 1685, Quinault est au faîte de sa carrière. Le Temple de la Paix, qui comptera parmi ses danseurs tout ce qu’il y a de plus brillant à la cour, est souvent considéré comme le dernier d’une longue lignée de ballets de cour. C’est une œuvre complexe et audacieuse, qui met en relief les différences entre la génération de Louis XIV et celle du Dauphin, commanditaire de l’œuvre. Créée trois jours après la révocation de l’Édit de Nantes, cette pastorale évoque les joies de la paix et du repos, les plaisirs et les peines de l’amour, le héros glorieux qui assure le bonheur des autres. Sa structure inhabituelle suggère, cependant, de nombreuses tensions.