Journée d’étude, jeudi 11 juin 2020, Université de Paris Est Créteil
« Problématique(s) de la fiction historique : frontière(s) des discours et des genres ? »
Organisation :
Agnès Edel-Roy (docteure et chercheuse associée, LIS),
Marie Florence Mbenoun (doctorante, LIS)
et Jaroslav Stanovsky (doctorant, LIS)
Pour l’EA 4395 « Lettres, Idées, Savoirs » (LIS, Université Paris Est Créteil)
Avec le soutien de l’École Doctorale « Cultures et Sociétés » (Université de Paris Est)
*****
La nature de la fiction dans ses relations à l’Histoire ne cesse de susciter l’attention des chercheurs, ainsi qu’en témoignent encore des ouvrages récents comme Fait et fiction – pour une frontière de Françoise Lavocat (2016) ou Les Bords de la fiction de Jacques Rancière (2017). Parmi les différentes fonctions de la fiction se trouve en effet sa capacité de témoigner de la réalité : « les fictions sont-elles génératrices du savoir, et, si oui, à quelles conditions ? » se demande Lubomír Doležel[1]. Au sein de cette problématique, la place centrale revient certainement à la fiction historique puisqu’elle prend pour cadre le passé. Selon Ivan Jablonka, « mimesis du réel, la fiction dit quelque chose sur la société, les groupes sociaux, les structures sociales, les rapports de classes, de production (…) à une époque donnée[2]. » Ce type de fiction, vaste dans ses formes (romans, bandes dessinées, films historiques mais aussi, partiellement, documentaires), se distingue par sa « double nature », entre art et réalité, amenuisant ainsi la frontière entre fiction et historiographie.
Définir la fiction historique dans ses particularités fait surgir un champ de questionnement relatif tant à la nature même de la littérature et de l’histoire qu’au débat sur la relation de l’histoire et de la littérature, dont l’une des traductions est l’opposition entre « monistes » et « dualistes », dès les années 1960. Les monistes (Roland Barthes dans ses essais « Introduction à l’analyse structurale des récits » et « Le discours historique », Hayden White dans Metahistory, Paul Ricoeur, partiellement, dans Temps et récit) soutiennent l’existence d’un seul mode du récit commun pour l’histoire et pour la littérature, les dualistes (Gérard Genette dans Fiction et diction, Lubomír Doležel dans Possible Worlds of Fiction and History, Françoise Lavocat dans Fait et fiction) défendent la pluralité des modes du récit.
Dans notre journée d’études, nous voudrions nous inscrire dans la lignée de ces débats tout en présentant des points de vue contemporains. Nous voudrions principalement examiner deux problématiques majeures. D’abord, comment définir la fiction historique ? Est-il possible de trouver une conception de la fiction historique qui traverse le temps et l’espace ou faut-il prendre en considération les contextes historiques et culturels relatifs ? Ensuite, quel est le potentiel cognitif de la fiction historique, sa capacité de transmettre, voire de créer, l’expérience de l’histoire ?
Le premier axe d’étude concernera donc les définitions possibles de la fiction historique. S’agit-il d’une catégorie qui traverse toute la littérature ou faut-il plutôt parler de la pluralité des fictions historiques ? Quant à la littérature française, peut-on inclure dans la même classe, par exemple, les récits médiévaux, les romans historiques « classiques » du XIXe siècle et les romans postmodernes ? Dans une perspective comparatiste, il serait intéressant aussi de se demander si la nature de la fiction historique française se rapproche ou non de celle d’autres littératures historiques, francophones ou étrangères (par exemple, les littératures russe ou espagnole). Si tant est que cette série de questions pourrait être résolue par la conception d’un cadre théorique valable pour l’ensemble des récits fictionnels historiques, quels critères seraient-ils susceptibles de former un tel cadre ? Les principes de la théorie des mondes fictionnels de Thomas Pavel, Umberto Eco, Ruth Ronen ? Ou la conception de la littérarité et l’approche fonctionnelle employées par les formalistes et structuralistes russes (Roman Jakobson), tchèques (Jan Mukařovský) ou français (Gérard Genette) ? Ou bien encore les approches pragmatiques qui s’intéressent à l’aspect communicatif du texte, à la relation spécifique établie entre l’auteur et les lecteurs ?
La deuxième problématique vise à examiner la dimension cognitive de la fiction. Quelle est sa capacité à transmettre des informations sur notre passé ? Peut-on donner raison à Ivan Jablonka qui insiste sur la nature mimétique de la fiction historique ou plutôt à Lubomír Doležel pour qui les univers créés par la fiction sont des « alternatives imaginaires du monde actuel[3] » ? Selon cette dernière théorie, la valeur cognitive de la fiction serait nécessairement limitée. Cet axe peut s’articuler autour de trois problématiques : Comment le discours littéraire dans les romans historiques coïncide-t-il avec d’autres types de discours (scientifique, philosophique, …) ? Quels procédés emploie la fiction historique pour produire le savoir ? Quel est le rôle de la fiction dans la création de la mémoire historique ?
Les questions formulées ci-dessus sont des propositions qui peuvent servir à interroger le vaste champ de la fiction historique. Nous accueillerons les propositions de communication de chercheurs dont les travaux et recherches portent sur la littérature historique, l’historiographie ou la théorie de la narration et la philosophie cognitive dans son articulation avec cette question de la fiction historique. Se limiter à un type de fiction ou à une époque particulière n’est pas un critère sélectif, nous voudrions plutôt proposer une gamme variée de communications. L’objectif de cette journée d’études est d’abord de réfléchir au phénomène de la fiction historique tout en s’inscrivant dans les tendances actuelles de la recherche sur les relations entre fiction et histoire.
*****
Les propositions de communication (maximum 300 mots) sont à envoyer au plus tard le 9 mars 2020, accompagnées de vos coordonnées et d’une courte bio-bibliographie, à l’adresse suivante : fiction-historique@mailo.com
Une réponse sera donnée par le comité scientifique le 3 avril 2020.
La journée d’étude se tiendra le jeudi 11 juin 2020, à l’Université de Paris Est Créteil, avec une prolongation possible le vendredi 12 juin 2020.
Comité scientifique : Agnès Edel-Roy (docteure et chercheuse associée, LIS), Vincent Ferré (Professeur, Littérature générale et comparée, UPEC, codirecteur du LIS), Mireille Labouret (Professeure émérite, Littérature française du XIXe siècle, UPEC), Marie Florence Mbenoun (doctorante, LIS), Yolaine Parisot (Professeure, Littératures francophones et comparées, UPEC, responsable de l’axe « Francophonie et échanges culturels » du LIS) et Jaroslav Stanovsky (doctorant, LIS).
Avec le soutien du LIS (EA 4395, dir. Vincent Ferré et Patrick Savidan) et de l’École doctorale « Cultures & sociétés » de l’université Paris Est (dir. M.-E. Plagnol).
*****
Bibliographie sommaire
BERNARD, Claudie, Le Passé recomposé. Le roman historique français du XIXe siècle, Paris, Hachette supérieur, 1996.
DOLEŽEL, Lubomír, Heterocosmica. Fiction and possible worlds, Baltimore/London, Johns Hopkins University Press, 1998.
DOLEŽEL, Lubomír, Possible Worlds of Fiction and History: The Postmodern Stage. Baltimore/London, Johns Hopkins University Press, 2010.
GENETTE, Gérard, Fiction et diction, Paris, Éditions du Seuil, collection « Poétique », 1991.
JABLONKA, Ivan, L’Histoire est une littérature contemporaine. Manifeste pour les sciences sociales, Paris, Éditions Points, 2017.
JAKOBSON, Roman, Huit questions de poétique, Paris, Éditions du Seuil, 1977.
JAMES, Alison et Christopher Reig (dir.), Frontières de la non-fiction, Presses Universitaires de Rennes, collection « Interférences », 2014.
LAVOCAT, Françoise (dir.), La Théorie littéraire des mondes possibles, Paris, CNRS Éditions, 2010.
LAVOCAT, Françoise, Fait et fiction – pour une frontière, Paris, Éditions du Seuil, collection « Poétique », 2016.
MUKAŘOVSKÝ, Jan, Écrits 1928-1946, Paris, Éditions des Archives Contemporaines, 2018.
PAVEL, Thomas, Fictionnal worlds, Cambridge, Harvard University Press, 1986.
RANCIÈRE, Jacques, Les Bords de la fiction, Paris, Éditions du Seuil, 2017.
RICOEUR, Paul, Temps et récit, Paris, Éditions du Seuil, 1983-1985.
RICOEUR, Paul, La Mémoire, l'histoire, l'oubli, Paris, Éditions du Seuil, 2003.
RONEN, Ruth, Possible worlds in literary theory, Cambridge, Cambridge University Press, 1994.
VEYNE, Paul, Comment on écrit l’histoire, Paris, Éditions du Seuil, collection « Points. Histoire », 1971.
WHITE, Hayden, Metahistory. The historical imagination in 19th century Europe, Baltimore/London, Johns Hopkins University Press, 1973.
[1] Lubomír Doležel, « Récits contrefactuels du passé », dans Françoise Lavocat (dir.), La Théorie littéraire des mondes possibles, Paris, CNRS Éditions, 2010, p. 96.
[2] Ivan Jablonka, L’Histoire est une littérature contemporaine. Manifeste pour les sciences sociales, Paris, Éditions du Seuil, coll. « Points », 2017, p. 189.
[3] Lubomír Doležel, Possible Worlds of Fiction and History: The Postmodern Stage. Baltimore/London, Johns Hopkins University Press, 2010, p. 40.

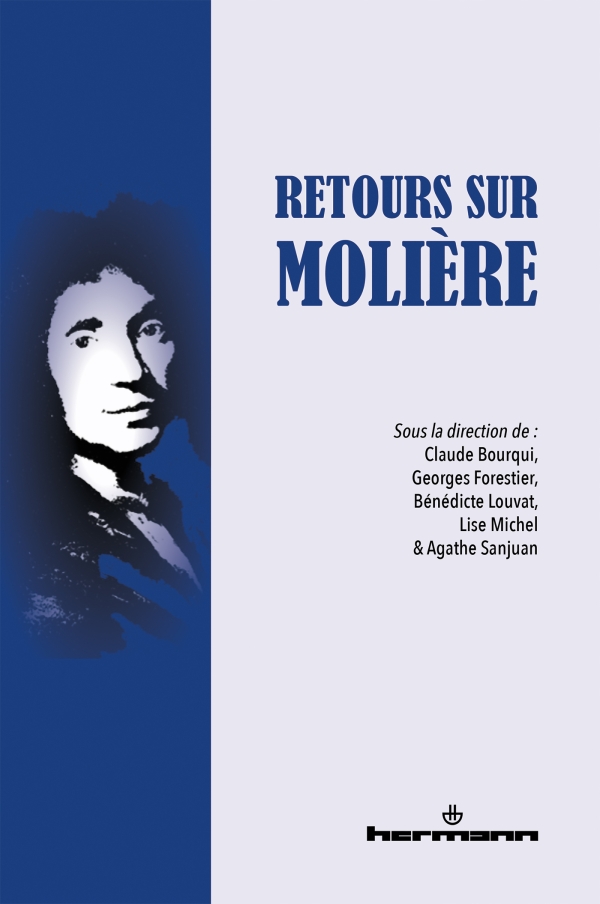 Retours sur Molière, dir. Claude Bourqui, Georges Forestier, Bénédicte Louvat, Lise Michel, Agathe Sanjuan, Paris, Hermann, 2022.
Retours sur Molière, dir. Claude Bourqui, Georges Forestier, Bénédicte Louvat, Lise Michel, Agathe Sanjuan, Paris, Hermann, 2022. Agrippa d'Aubigné, Œuvres. Tome II. La Responce de Michau l’aveugle, La Replique de Michau l’aveugle, avec les pièces catholiques de la controverse, éd. Jean-Raymond Fanlo, Paris, Classiques Garnier, 2022.
Agrippa d'Aubigné, Œuvres. Tome II. La Responce de Michau l’aveugle, La Replique de Michau l’aveugle, avec les pièces catholiques de la controverse, éd. Jean-Raymond Fanlo, Paris, Classiques Garnier, 2022.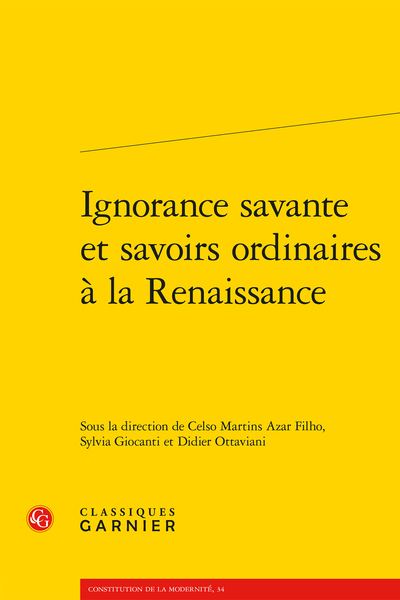 Ignorance savante et savoirs ordinaires à la Renaissance, dir. Azar Filho (Celso Martins), Giocanti (Sylvia), Ottaviani (Didier), Paris, Classiques Garnier, 2022.
Ignorance savante et savoirs ordinaires à la Renaissance, dir. Azar Filho (Celso Martins), Giocanti (Sylvia), Ottaviani (Didier), Paris, Classiques Garnier, 2022.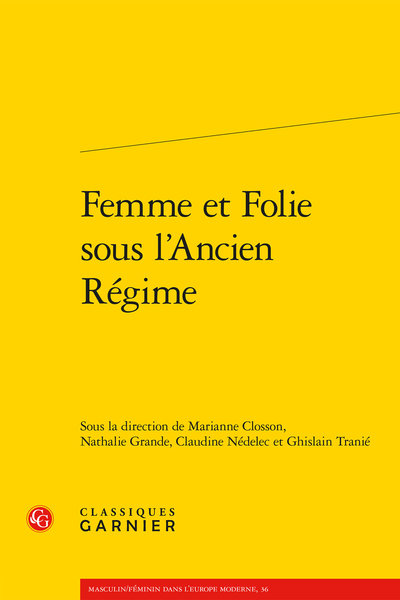 Femme et Folie sous l’Ancien Régime, dir. Closson (Marianne), Grande (Nathalie), Nédelec (Claudine), Tranié (Ghislain), Paris, Classiques Garnier, 2022.
Femme et Folie sous l’Ancien Régime, dir. Closson (Marianne), Grande (Nathalie), Nédelec (Claudine), Tranié (Ghislain), Paris, Classiques Garnier, 2022.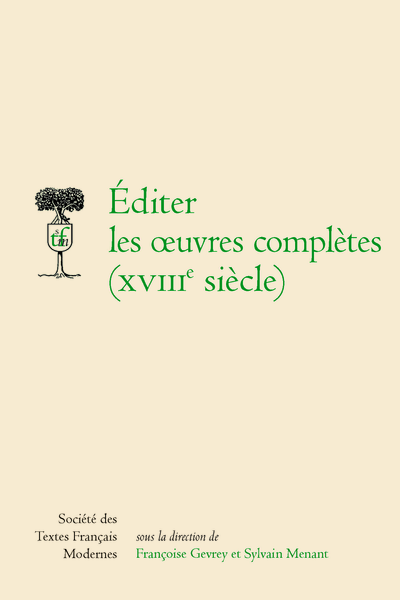 Éditer les œuvres complètes (xviiie siècle), dir. Françoise Gevrey et Sylvain Menant, Paris, Classiques Garnier, "STFM", 2022.
Éditer les œuvres complètes (xviiie siècle), dir. Françoise Gevrey et Sylvain Menant, Paris, Classiques Garnier, "STFM", 2022.